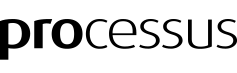INTERVIEW
- Comment la photographie est-elle entrée dans votre vie ?
Jérôme Brézillon : Mon père faisait des photos d'amateur et avait lancé un concours photo, au sein de notre cercle de famille et d'amis. Il y avait une dizaine de thèmes proposés et à l'issue de ce concours, on organisait un dîner, avec projection de diapo, votes, et élection du gagnant. J'ai participé à ce concours, ce furent mes premières photos – j'avais onze ou douze ans. J'ai traité les dix thèmes avec un seul film – rentable... ! (rires) Et puis mon père était abonné à
Actuel, je faisais attention à leurs photos. De là, j'ai commencé à réfléchir à comment faire une photographie, comment raconter quelque chose avec une photographie.
- Vous vouliez déjà en faire votre métier ?
JB : Pas vraiment... Je ne savais pas que c'était un travail. Pour moi, la photographie, ça n'était pas un vrai métier ! J'ai d'abord voulu devenir chef opérateur, dans le cinéma, je suis entré à Censier, à la fac. La même année, on a proposé à l'un de mes amis d'être assistant de photographe, comme job d'été, chez un photographe de nature morte. Il n'a pas pu le faire, je l'ai remplacé. Et je ne suis jamais retourné à la fac. J'ai continué à être assistant, jusqu'à ce que je monte mon propre studio. J'avais une vingtaine d'années. Tout marchait plutôt bien, j'avais pas mal de clients.
- Et la rupture alors ?
JB : En 1992, j'ai tout arrêté. J'en avais tout simplement assez des packshots, des catalogues. Je suis parti aux Antilles, sur un bateau. À mon retour, j'avais tout perdu, mes clients, mon réseau, mon studio. Je suis reparti de zéro. J'ai fait mes premiers reportages sur Rungis et sur la boxe thaï en banlieue. Et, de '92 à '96, j'ai fait des aller-retours en Bosnie, couvrir le conflit ex-Yougoslavie.
- Quels sont les photographes dont vous appréciez le travail ?
JB : Le tout premier livre de photo que j'ai acheté, ce fut un livre de Jean-François Jonvelle. Le deuxième, ce fut
Visages de l'Ouest, de Richard Avedon. Mais très tôt, je me suis intéressé de près aux photographes de guerre, Philip Jones Griffiths, David Douglas Duncan, Don McCullin, Larry Burrows, et à Magnum, Gilles Peress, Raymond Depardon pour ses travaux sur le texte allié à l'image, ou Alec Soth… Je regarde beaucoup de photos, et j'achète beaucoup de livres. Récemment il y a eu Pieter Hugo, William Christenberry, Mitch Epstein. Avec mon premier voyage aux États-Unis en 1989, j'ai découvert les photographes américains tels que Walker Evans, Robert Adams, Lewis Baltz. J'aime aussi particulièrement le travail des coloristes tels que William Eggleston, Stephen Shore, Joel Meyerowitz...
- Justement, depuis près de dix ans, tous vos projets personnels ont pour cadre le territoire américain : les États-Unis occupent une place prépondérante dans votre travail photographique.
JB : J'essaye de m'en détacher, de passer à autre chose, d'aller vers d'autres lieux, vers d'autre gens... mais chaque fois je retourne là-bas. Il suffit que les frères Cohen sortent un nouveau film, ou que j'écoute un disque du label Fat Possum et j'ai envie de repartir. Et chaque fois je suis content d'y être.
- L'une de vos premières étapes fut Huntsville, au Texas.
JB : L'idée de raconter cette ville m'intéressait. Comment imaginer à quoi peut ressembler la vie quotidienne d'habitants d'une ville dans laquelle la mort est à la fois banale, anonyme et abstraite. J'y ai cherché de l'action, je voulais aller à la rencontre des gens. J'ai dû me faire une raison : dans les rues d'Huntsville, il ne se passe quasiment rien. J'ai réalisé que c'était justement cela, qu'il fallait capter. Ensuite il y eu le documentaire de Solweig Anspach sur Odell Barnes [jeune Noir de 31 ans victime d'une erreur judiciaire et exécuté le 1er mars 2000]
Made in the USA. Une contre-enquête, au cours de laquelle elle interroge les amis d'enfance Odell Barnes, sa famille, le juge, le médecin légiste. Dans son film, les lectures des dépositions sont illustrées par mes photos, qui reviennent sur les lieux clés du drame. Là encore, mes images ne montrent pas l'action, elles ne le peuvent pas. Et pourtant elles racontent une histoire.
- Autre série. 2004 : les Sioux Lakotas du sud Dakota. Plusieurs voyages à Pine Ridge donneront naissance à la série “Souverains”. Comment est née cette série ?
JB : Je voulais aller "voir " les Indiens. Me confronter à cette vision un peu romantique que j'avais de ce peuple. Seulement si tu n'as pas des amis là-bas, ou de bonnes raisons d'y aller... t'as rien à y faire. À moins d'être photographe justement. J'ai voulu aller à la rencontre des gens, qu'il se passe quelque chose avec eux, c'est comme ça que j'ai réalisé cette série.
- Dernier projet en date : les images prises des trains.
JB : J'ai débuté cette série l'année dernière, premier voyage : Chicago-Seattle, Seattle-Los Angeles, Los Angeles-Chicago. Deuxième étape (j'en reviens) : Los Angeles-New Orleans-Chicago-Miami-Washington-New-York-San Francisco- et retour à Los Angeles. 8 stop. 15 jours de train, 53 heures de voyage, 14000 km, 70 rouleaux 135. Que de la couleur. En comptant mon premier voyage, j'avoisine les 20 000 km. Par rapport à mes précédentes séries, sur la neige par exemple, la démarche est totalement différente : pour ces séries, je laissais beaucoup de place au hasard, sans idée précise, j'écoutais la radio et j'allais là où l'on annonçait une tempête de neige, je ne dormais jamais deux nuits au même endroit. Parfois, c'était simplement le nom d'une ville qui m'attirait. Pour les trains, c'est différent, c'est le paysage qui vient à toi, comme au cinéma, et mon parcours est très réfléchi, très préparé.
- La série avance bien ?
JB : C'est trop tôt pour le dire. Je n'ai pas encore regardé les tirages de lecture. Je n'ai pas ouvert la boîte. Ils sont rangés dans leur pochette cristal. J'attends encore un peu avant d'aller voir. Je suis souvent déçu au retour d'un voyage. Je sais que j'ai raté certaines photos que je pensais vraiment avoir réussies, heureusement j'en découvre d'autres. J'aime aussi partager l'éditing de mes planches contact avec des gens en qui j'ai confiance. Parfois tu t'obstines à t'attacher à une photo un peu faible juste parce que tu étais tellement persuadé en la faisant que ce serait une bonne photo, ou simplement parce que le moment était en lui-même exceptionnel, tu t'accroches à cette idée alors que je résultat n'est pas là. Partager le regard, ça aide. Et je préfère toujours laisser passer un peu de temps.
- De tous ces voyages, toutes ces rencontres, quelles petites histoires vous reviennent ?
JB : Des petits ratages : une manif, par exemple, que je devais photographier pour Laurent Abadjian, de
Télérama : j'arrive à l'heure au rendez-vous mais le cortège est parti en avance. Ce qui n'arrive jamais. Je les rattrape, je saute de la moto, je shoote (c'était en argentique à l'époque), je rentre au journal, je fais développer mes films... je m'étais trompé de manif, j'avais pas shooté la bonne...
Une série de photos dans la neige : une heure de marche au petit matin, paysages blancs immaculés, et je finis par m’apercevoir que mon objectif est plein de buée ! (J'utilise un appareil télémétrique et mon viseur, lui, n'avait pas de buée.) J'ai reshooté tout le film, image par image en remarchant dans mes propres traces. Résultat : deux séries identiques. Il n'y avait finalement pas de traces de buée sur la première.
De belles rencontres, aussi : Alain Bashung sur le tournage du film de Charlotte de Turckeim «
Mon père, ma mère, mes frères et mes soeurs », au Mexique, pour le magazine
Studio... R.L. Burnside, musicien et chanteur de blues américain, pour ma série sur le Mississippi, qui m'a dit, alors que je m’apprêtais à le photographier, que, de toute façon, il n'apparaissait jamais sur les photographies, jamais. Résultat, je rentre à Paris : mes photos avaient subi les rayons X à l'aéroport en rentrant des États-Unis.
- Vous êtes allé à la rencontre des Indiens au cours de vos nombreux voyages aux États-Unis. Au commencement de la photographie, les Indiens craignaient qu’on ne vole leur âme si un photographe faisait leur portrait : qu'en est-il aujourd'hui de cette peur instinctive ?
JB : Je connais un peu les Sioux Lakotas : plus ils aiment les dollars, et plus ils ont peur qu'on leur vole leur âme !
- En dehors des reportages, vous faites également des portraits. Comment se passent les prises de vue pour les portraits ?
JB : J'attache autant d'importance à l'environnement qu'à la personne que je photographie, et comment le sujet occupe cet espace. Je dirige peu. J'ai juste horreur des mains dans les poches et des déhanchements.
- En tant que photographe, diriez-vous que c’est, de vos cinq sens, la vue qui vous procure le plus d’émotions ?
JB : Je trouve parfois que certaines photographies manquent de sons.
- Qu'est-ce qui vous permet de reposer vos yeux et de ressourcer votre envie de photographier ?
JB : Mes fils, parce qu'ils voient des choses que je ne vois pas.
- Diriez-vous que vous n’imaginez pas vous passer de prendre des photos ? Est-ce une activité vitale pour vous ?
JB : La photographie permet vraiment d'aller ailleurs.
- Que vous inspire la nouvelle génération de photographes ? En quoi est-elle différente de la vôtre ?
JB : J'ai le sentiment que la nouvelle génération réfléchit davantage. La mienne était plus intuitive et laissait plus de place à l'improvisation. Ni mieux, ni moins bien.
- Quel conseil donneriez-vous à un jeune photographe ?
JB : Fais des photos.
- L’art du portrait est très ancien. Il se place au fondement même des premières photographies. Il est également chargé d’une riche tradition picturale. Comment situez-vous ce travail photographique, par rapport à la peinture ?
JB : Je pense que Lucian Freud est un remarquable photographe, et que Richard Avedon et Antoine d'Agata sont de très bons peintres.
- Que pensez-vous du comparatif argentique / numérique ?
JB : Quand il n'y avait que l'argentique, acheter ses films avait quelque chose de précieux, à présent, ça n'a plus de valeur. Dans tous les sens du terme. Le numérique a démocratisé la photographie. Tout semble possible maintenant. Un négatif, ça ne pardonne pas. Avec les possibilités actuelles du numérique, le paradoxe est là : un mauvais photographe peut faire une bonne photo (ce qui fait de lui un bon photographe).
Là, par exemple, je reviens des États-Unis, pour ma série sur les trains. J'ai choisi de travailler en argentique, et j'ai opté pour un Leica 24x36. Avec mon Nikon, je me serais facilité les choses : je pouvais monter plus haut en vitesse, et aller plus loin en sensibilité... Mais au fond, ce que je voulais, c'est capter l'aspect fugitif de ces paysages, ce que la contrainte du Leica rendrait très bien. Je n'aime pas trop les boîtiers numériques. Je reste très attaché à la mécanique, au bruit… un truc de vieux? (rires) Avec le Leica entre les mains, tu sens qu'il se passe quelque chose. Avec un 5D, il n'y a pas le même contact. En numérique, tout est devenu nickel, tout est parfait, tout se ressemble, et ça me lasse. Je cherche au contraire à rendre la fragilité des images, c'est cela que j'aime.
QUESTIONS SUBSIDIAIRES
- Quel métier auriez-vous aimé faire (à part photographe) ?
JB : Bûcheron.
- Quel métier n'auriez-vous pas aimé faire ?
JB : Directeur du FMI.
- Quelle est votre drogue favorite ?
JB : R.L. Burnside.
- Qu’est-ce qui vous fait réagir le plus de façon créative, spirituellement, ou émotionnellement ?
JB : Les caresses.
- Qu’est-ce qui, au contraire, vous met complètement à plat ?
JB : La chimiothérapie.
- Quel bruit ou quel son aimez-vous faire ?
JB : Chut.
- Quel bruit, ou quel son détestez-vous ?
JB : La lime à ongles.
- Qui aimeriez-vous shooter pour mettre sur un nouveau billet de banque ?
JB : Bernard Tapie.
- Quel est votre juron, gros mot, blasphème favori ?
JB : «
Merde ».
- Quel le don de la nature aimeriez-vous avoir ?
JB : Nyctalope.
- Avez-vous un objet fétiche, un porte-bonheur ?
JB : Un coquillage.
- Quelle est la plante, l’arbre, l’animal dans lequel vous aimeriez être réincarné ?
JB : Un gorille, un bon vieux « dos argenté ». On le laisse tranquille.
- À quoi vous sert l’art ?
JB : À s'intéresser à l'autre.
L'ARRÊT SUR IMAGE de Jérôme Brézillon
Le photographe Jérôme Brézillon décrypte pour nous, ce mois-ci, l'une de ses images.
STAND ART LIFE. USA. Sud Dakota.
JB : C'était au petit matin. Je réalisais ma série de photographies de neige. J'ai été attiré par cet auvent rouge qui se détachait dans le paysage, et cette enseigne « burgers fries pop ». Il y avait un lampadaire allumé, qui diffusait un halo jaune, et au-delà, sol blanc, ciel blanc, neige à perte de vue. C'était très beau. J'ai installé mon trépied, choisi mon cadre ; j'étais en 6x7. Au moment où j'ai déclenché, le halo s'est éteint. Le jour venait de se lever... Je me suis demandé s'il fallait attendre le lendemain matin pour refaire l'image telle que je l'avais voulue. Finalement je suis parti. Une seconde avant, et cette image aurait été différente, mais je l'aime comme ça.
UN PHOTOGRAPHE + UN LABO
Jérôme Brézillon & Processus
- Pourquoi avez-vous choisi Processus ?
JB : J'y trouve une grande fluidité ; c'est l'avantage des petites structures. Techniquement, ils sont très bons, mais la photographie, ce n'est pas que de la technique, loin de là. Le côté humain est capital, trouver des gens avec qui tu as envie de passer du temps, avec qui tu es en accord sur le travail. C'est une histoire de rencontres.
FOCUS
Stand Art Life
En 2002, Jérôme Brézillon part aux États-Unis photographier les paysages enneigés du nord Dakota, puis en 2003 et 2004 il se rend en Louisiane, en Alabama, et au Mississippi. Au final, cinquante photographies sont réunies dans un ouvrage intitulé
Stand Art Life (éditions Trans Photographic Press).
On Board
Depuis fin 2009, Jérôme Brézillon a entamé un nouveau travail intitulé «
On Board». Des paysages, toujours aux États-Unis, pris à travers les vitres de trains en marche.
JB : « Les trains américains sont lents et permettent de voir venir, les décors apparaissent, disparaissent, le hasard a sa place, les images sont fragiles et furtives, la vitre leur donne un aspect diffus. Je deviens spectateur, comme si je photographiais pendant un travelling interminable. »
Souverains
Depuis fin 2004, Jérôme Brézillon photographie les Sioux Lakotas du sud Dakota. Plusieurs voyages à Pine Ridge donneront naissance à la série «
Souverains».
JB : Je voulais aller
voir les Indiens. Me confronter à cette vision un peu romantique que j'avais de ce peuple... Seulement si tu n'as pas des amis là-bas, ou de bonnes raisons d'y aller... t'as rien à y faire. À moins d'être photographe justement. J'ai voulu aller à la rencontre des gens, qu'il se passe quelque chose avec eux, c'est comme ça que j'ai réalisé cette série.
Interview : Sandrine Fafet
(Juin 2011)