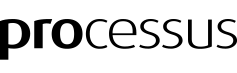INTERVIEW
- Premiers contacts avec la photographie ?
Gilles Leimdorfer : Le Dieu de la photographie m'a visité au mois de mai 1979 et il m'a dit : "Gilles, tu seras photographe".
J'avais 13 ans, et, en lisant le magazine
Photo du mois de mai 1979, j'ai eu cette révélation. Je m'en souviens très bien. Pourquoi, précisément, je n'aurais plus vraiment su le dire… et puis, il y a cinq ou six ans, alors que je rendais visite à la rédaction de ce magazine justement, il m'est venu l'idée de leur demander de me montrer ce fameux numéro du mois de mai 1979… Et là, j'ai été sidéré. Dans ce numéro, il y avait toutes mes préoccupations de photographe : une rétrospective photo-journalistique des prix Pulitzer, un portfolio de Raymond Depardon (que je ne connaissais pas à l'époque), et un portfolio de Joel Meyerowitz (qui n'était pas aussi connu alors qu'il l'est aujourd'hui).
Voilà. Le point de départ. Après… il s'est passé plein de choses.
- Donc un terrain familial propice à la photographie au départ ?
GL : La famille du côté de mon père, et mon père lui-même, étaient des amateurs de photographie. Mon grand-père avait un Rollei, mon père photographiait en 24x36, au Minolta. Un de mes premiers souvenirs en photo, par exemple, c'est Duane Michals, un portfolio du magazine
Photo. Je devais avoir 8 ou 9 ans et j'avais été fasciné par cet univers un peu inquiétant. J'aimais aussi beaucoup Ralph Gibson et Elliott Erwitt. Sans trop me demander si ces types étaient importants ou pas. Mais j'avais été familiarisé assez tôt avec l'idée que la photographie, c'était davantage que des photos de vacances, je savais que c'était une activité sérieuse, artistique, une belle chose, pas simplement quelque chose que l'on faisait juste comme ça, avec son Instamatic. Photographe, c'était un métier.
- Et comment la photographie est-elle devenue votre métier ?
GL : J'ai d'abord fait des études de droit pour faire plaisir à mes parents, pour les rassurer, avec l'idée de faire ensuite une école de journalisme. Comme je réussissais assez bien dans ces études universitaires, j'ai senti qu'il fallait vite que je m'en extirpe, sinon, j'allais être happé par le système et j'allais passer à côté de mon rêve - qui était déjà de devenir photographe. Je n'ai pas fait d'école de photo. Je suis devenu photographe en travaillant. J'ai commencé par des petits boulots (visites officielles et remises de médailles pour la mairie du XVème, par exemple. Assistant de plateau chez PIN-UP).
Mais très vite, j'ai eu la chance de devenir pigiste à l'AFP et cela a marqué le début de ma carrière. Je suis arrivé au bon moment ; un chef de reporters prenait ses fonctions. J'ai été son premier rendez-vous. Il a dû se marrer en me voyant arriver dans son bureau (j'étais tout jeune, j'avais 22 ans) tandis que lui était quelqu'un de très imposant, charismatique : un vrai reporter de l'AFP. Il m'a fait faire une pige, puis 2, puis 3 et puis je suis resté pigiste permanent au bureau de Paris.
- Être photographe à l'AFP, cela consiste en quoi ?
GL : Tout photographier. Toute l'actualité. Expérience très formatrice, aussi bien photographiquement qu'humainement. Je me retrouvais dans la cour de l'Élysée, dans une banlieue chaude ou dans un ministère, j'assistais à une réunion politique, à une manif, à une course de vélo, une conférence de presse ; j'avais rendez-vous avec de grands patrons, des SDF, je pouvais couvrir une première de cinéma ou un fait divers crapuleux. Tout. Tout ce que l'on découvre le matin dans son journal. Tu découvres le monde.
Cela m'a appris à travailler, et à travailler d'une façon très particulière. Il fallait faire très peu de photos, par exemple. Non pas par soucis d'économie, mais pour gagner du temps. On transmettait les photos - pas encore par informatique bien sûr - mais par téléphone, avec le belin. Et il fallait aller vite.
- Le belin, c'est-à-dire... ?
GL : Le bélinographe. Aujourd'hui, tout passe par internet évidemmment, mais on sait transmettre des images depuis la première guerre mondiale. Le bélinographe est un système de cylindre qui convertit les niveaux de gris en fréquences (aiguë pour le blanc, grave pour le noir) et qui les transmet en ligne. Et à l'autre extrémité du téléphone, il y a un système de tambour, synchronisé avec un cylindre identique dans une chambre noire où arrive l'image. En 1988, c'était déjà un peu la fin du bélinographe. Mais grâce à ce système, n'importe quel événement dans le monde, 2 heures après, avait sa photo dans les rédactions. Maintenant, bon, pour n'importe quel événement, c'est 200, 300, 500 images. Mais déjà à l'époque on était capable de transmettre des images. Et donc, pour aller vite, il fallait faire très peu de photos. On développait tout de suite les négatifs. On éditait directement sur le négatif - à peine sec - posé sur la table lumineuse - sans planche contact : pas le temps - pour savoir quelle image unique illustrerait l'événement en question.
Et puis, au bout de 4 ans, j'ai eu envie de changer d'air. De changer de pratique. J'étais attiré par le monde des agences de magazines...
- Vous avez travaillé à l'AFP, ensuite dans des agences photos telles que R.É.A ou Rapho. Dans votre pratique professionnelle, que pensez-vous du comparatif argentique / numérique ?
GL : En 1988, à l'AFP, on commençait tout juste à travailler en négatif couleur. Quelques mois auparavant, on chargeait encore un boîtier en négatif N&B et un boîtier en ekta couleur. Ensuite, à R.É.A. je me suis mis à travailler uniquement en ekta. Et puis je suis passé aux négatifs couleurs (avec le Leika), que je numérisais ensuite.
J'adorais le Leika et pour moi, le passage au 100 % numérique a été un crève-coeur. Abandonner le Leika, cela a été horrible. Abandonner la Kodachrome, un déchirement… Et puis le numérique, avec ses appareils très utilitaires, sans âme, ne m'a jamais beaucoup emballé. Comme tout le monde, je m'y suis mis, mais j'ai eu énormément de mal. La difficulté essentielle a été pour moi de reconstruire mon rapport à l'image.
Gérer le problème de l'instantanéité notamment : voir ta photo en même temps que tu la fais m'a énormément déstabilisé dans mon processus de création. Je n'ai véritablement réussi à maîtriser le numérique que le jour où j'ai fait une série perso par ce biais. Je n'étais pas très content de le faire, mais j'ai bien senti que si je voulais maîtriser le numérique convenablement, il fallait que je m'approprie l'outil. Et la seule façon de le faire, c'était non pas de refaire un travail de commande, un de plus, car finalement, cela ne me posait plus aucun problème - mais un travail véritablement personnel, avec l'outil numérique, pour vraiment me fixer par rapport à lui, vraiment y réfléchir. Et finir par faire des images intéressantes.
- C'est ainsi que vous avez repris le Tour de France ?
GL : Oui. En regardant les photos faites au Leica, je me suis dis : "Non, tu n'as pas fini, ce travail n'est pas terminé. Il faut que tu le continues". Et là, j'ai travaillé en numérique, tout en gardant le même format, les mêmes chromies. Cela m'a permis de retrouver mes couleurs - en numérique - en partant de la première mouture sur négatif couleur numérisé, travaillé sous Photoshop. Et finalement, cela a été assez facile de lier les deux travaux.
- Le numérique a-t-il changé votre pratique de l'argentique ?
GL : Oui, d'une certaine façon. J'ai commencé le moyen format et le travail à la chambre, et c'est le numérique qui m'y a poussé. Par besoin d'une pratique plus manuelle, où tu sens les choses. Le côté sensuel de la photographie - pas seulement des 0 et des 1. Ce que j'aime, dans le travail à la chambre et dans le travail argentique en général, c'est que cela reste un travail sur la matière. Tu manipules ta chambre, tes films, et ensuite, quand tu vas au labo, les négatifs, la planche-contact. Il y a tout un travail autour de la matière qui était vraiment très important pour moi, et que j'ai eu impression de perdre avec l'usage du numérique.
Ce que j'aime dans la vraie photo argentique, c'est qu'elle est un "objet photographique", tandis qu'en numérique, la photo n'est qu'une "image". Je me suis aperçu de cela dans les ventes à Drouot notamment. Là-bas, quand tu vois passer un tirage, tu as un véritable objet entre les mains. Il y a une présence que les tirages numériques n'ont pas.
Et puis le numérique t'éloigne de tes capacités d'observation, et en particulier du sens de la lumière. Dans mon travail de photographe, je me place d'abord par rapport à la lumière - et ensuite, seulement, par rapport à l'action. Quand j'étais photographe reporter à l'AFP, au contraire, je me plaçais d'abord par rapport à l'action. On mettait des coups de flash s'il le fallait, mais on faisait la photo là où cela se passait. Maintenant, s'il n'y a pas la bonne lumière, je ne fais pas la photo. Cela ne m'intéresse pas. Parce que je ne pourrais pas faire l'image que j'attends. Et justement, le numérique t'éloigne un peu de ce sens-là. Ce que j'aime dans le travail argentique, c'est le fait que cela t'oblige à beaucoup plus imaginer ta photo, la réfléchir, tu es davantage en danger aussi, tu ne vois pas ce que tu fais, tu es en attente. Je suis né en 1964, mes premières expériences photos, se sont des clubs photos où l'on regarde l'image apparaître sur le tirage. Moi, je suis né à la photo avec cette magie-là, et je vais continuer avec cette magie.
Je comprends très bien qu'un jeune photographe n'ait pas nécessairement envie de faire de l'argentique parce qu'il n'a pas connu ce truc-là et tant mieux, parce qu'il va pouvoir faire exploser d'autres outils. La nouvelle génération sera capable de faire des choses que je ne peux pas imaginer. Mais moi, je ne peux pas laisser derrière moi toute mon expérience argentique parce que le numérique est arrivé. Au contraire. J'ai fait tout un travail autour de cela, qui continue de mûrir, qui continue d'avancer.
- Les bons côtés du numérique ?
GL : Le numérique a considérablement facilité mon travail de commande. Tout va plus vite, tu peux faire beaucoup plus de photos et tu peux faire des photos dans des conditions où il était inimaginable de travailler avant. Comme je fais beaucoup de corporate, que je travaille beaucoup dans le milieu de l'entreprise, je suis souvent confronté à des conditions de lumière difficiles : les usines, par exemple, où les néons sortaient vert en ekta ; il fallait alors tout ré-éclairer, c'était l'enfer. Ce que je fais aujourd'hui en une journée en numérique, il me fallait 3 ou 4 jours avant en argentique pour le réaliser.
- Quel conseil donneriez-vous à un jeune photographe ?
GL : Tout faire pour conserver l'envie de photographier et se ménager du temps pour travailler pour soi, parce qu'il n'y a que cela pour donner du sens à son propre travail. Ce n'est pas en réalisant des commandes que l'on donne du sens. Le travail personnel doit rester central. Et se méfier des trompettes de la renommée. Succès éclatant. Un an après, plus rien. Photographe, c'est le travail d'une vie.
- Dans votre travail personnel, justement, vous avez, jusqu'à présent, essentiellement consacré votre énergie à la France, pour quelle raison?
GL : J'ai toujours voulu parcourir la France, avant même que Depardon ne s'en occupe. Cela a toujours été une préoccupation pour moi. Et il y a plusieurs raisons à cela : jeune, j'avais été très impressionné par les images de Salgado sur l'Amérique latine. J'avais trouvé incroyable que ce type agisse chez lui. Je me suis dis : si l'on veut vraiment travailler en profondeur, c'est peut-être chez soi qu'on le fait le mieux et pas nécessairement à l'étranger, en allant loin.
Deuxième raison : voyager coûte cher et je n'avais pas beaucoup d'argent à l'époque. Faire des photos devant sa porte ou dans son propre pays facilite l'organisation et limite évidemment le budget.
Et enfin, une volonté de m'extraire de la "nouveauté". En voyage, ce qui m'attire, bien sûr, c'est l'exotisme, la différence, toutes les choses auxquelles je ne suis pas habitué. Mais en tant que photographe, je cherche davantage à poser véritablement un regard sur les choses qui m'entourent et que je crois connaître. Je trouvais donc plus pertinent d'aller vers une réalité familière et d'essayer de l'observer. Je sens que j'ai vraiment quelque chose à faire aboutir en France et tant que, à mon sens, je ne l'aurai pas achevé, j'aurai du mal à m'impliquer dans un projet à l'étranger. Par exemple, j'ai très envie de travailler sur Istanbul, et sur ce grand pays qu'est la Turquie. Mais il me faudrait 700 jours dans l'année pour pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire… !
- Quels sont les photographes qui vous ont marqué ?
GL : La liste est longue…
- Et si vous deviez n'en citer que trois ?
GL : Joel Meyerowitz. Raymond Depardon, qui a aussi beaucoup compté dans mon parcours… et… le troisième…
Ado, c'était Ernst Haas. Aujourd'hui, William Eggleston peut-être… ou alors Edward Curtis, ou Dorothea Lange, Diane Arbus, ou Richard Avedon, Stephen Shore, ou bien Edward Hopper…
- Un peintre, alors ?
GL : Le 3ème photographe, oui, ce serait le peintre Edward Hopper, j'assume ! Pour ses accords de couleurs, ses cadrages, ses thématiques. Ce n'est pas le déchaînement de Mozart. C'est au contraire le travail de toute une vie. Se nourrir de plein de choses, se nourrir de tout ce à quoi on n'a pas accès avec son propre medium, parce la photographie a elle aussi ses limites, c'est important.
- Quelle est l’activité qui vous permet de reposer vos yeux et de ressourcer votre envie de photographier ?
GL : La lecture et la vie de famille. Parce que quand je fais des photos, je ne dois faire que ça. Me plonger dans un univers, dans un lieu, et faire des images. Je ne peux pas avoir l'appareil photo quelque part près de moi et boum. J'ai besoin de concentration. De m'extraire de tout. M'immerger. Oublier tout le reste. Je ne peux pas photographier tout le temps. Je pense par exemple au travail de Patrick Taberna, qui photographie son quotidien. Moi, je ne sais pas faire cela. Donc, en vacances, pas de photo, pour faire un break, nettoyer l'oeil.
- À quoi sert un photographe ?
GL : Il sert à transmettre. Un témoignage de son époque. À travers ce qu'il photographie autant que par la façon de le faire.
Ce qui me gène dans beaucoup d'images que je vois actuellement, (images publicitaires, presse…) c'est que j'y vois des sortes de constructions artificielles qui nous éloignent de la réalité. Image - imaginaire - imagination, même racine. L'une des grandes raisons du malaise social, à mon avis, c'est le fait que les images dont on est bombardé en permanence, et qui finissent par construire notre imaginaire, ne correspondent pas à la réalité, et le gap entre les deux nous rend mal à l'aise. Le travail du photographe - documentaire - devrait aussi permettre de se réconcilier avec la réalité. Pour se sentir mieux.
QUESTIONS SUBSIDIAIRES
- Quel (autre) métier auriez-vous aimé faire ?
GL : Instituteur.
- Quel métier n'auriez-vous pas aimé faire ?
GL : Flic.
- Quelle est votre drogue favorite ?
GL : La lecture.
- Qu’est-ce qui vous fait réagir le plus de façon créative, spirituellement, ou émotionnellement ?
GL : La photo... oui.
- Qu’est-ce qui, au contraire, vous met complètement à plat ?
GL : Le solstice d'hiver.
- Quel bruit, quel son, aimez-vous faire ?
GL : Le déclencheur au 1/30 s (selon les appareils au 1/15 s… mais plutôt au 1/30 s).
- Quel bruit détestez-vous entendre ?
GL : Tout bruit susceptible de me réveiller en pleine nuit.
- Qui aimeriez-vous shooter pour mettre sur un nouveau billet de banque ?
GL : Bernard Arnault.
- Quel est votre juron, gros mot, blasphème favori ?
GL : "Putainfaitchier" en-un-seul-mot.
- Quel don de la nature aimeriez-vous posséder ?
GL : Parler toutes les langues.
- En quoi aimeriez-vous être réincarné(e) ?
GL : En photographe… (je veux un tour gratuit !)
SI VOUS ÉTIEZ
- Une couleur ?
GL : L'accord de couleurs rouge/vert.
- Une chanson ?
G
L :
Thunder Road, de Bruce Springsteen.
- Un objet ?
GL : Un livre :
Martin Eden, de Jack London.
- Un sentiment ?
GL : L'amour.
- Une/un artiste ?
GL : Bach.
- Un alcool ?
GL : Un Gevrey-Chambertin.
- Une œuvre d’art ?
GL :
La Monumenta de Richard Serra.
UN PHOTOGRAPHE + UN LABO
Gilles Leimdorfer & Processus
- Pourquoi avez-vous choisi Processus ?
GL : J'ai connu Processus en 2003, par le magazine
Télérama.
À l'époque où je travaillais pour l'agence Rapho, j'allais régulièrement dans tous les grands labo parisiens. Mais Processus s'est vite imposé pour de nombreuses raisons. En argentique, tout d'abord, il y a eu les prix. Sans comparaison.
Deuxième raison : l'accueil. Que tu sois un grand photographe ou un client de passage, tu es accueilli comme tous les autres clients, à Processus, et cela, vraiment, c'est très agréable. Parce que, dans les autres grands labo, quand tu arrivais et qu'on ne te connaissait pas, tu étais un peu reçu "comme une merde". Là, à Processus, c'était quand même autre chose. Et puis surtout, qui que tu sois, le travail reste le même. On ne m'a jamais planté des pinces dans la 36ème ou la 37ème vue de mon rouleau 24x36 - dans d'autres "grands-labos-parisiens" c'était quasiment systématique. À l'usage, en plus d'être moins cher et d'être beaucoup plus sympa, Processus travaille mieux et donc, au fil du temps, j'ai pris mes petites habitudes là-bas…
L'ARRÊT SUR IMAGE de Gilles Leimdorfer
C'est le photographe Gilles Leimdorfer qui zoome ce mois-ci pour Processus, sur l'une de ses images.
GL : C'est ma "première photo", la première qui vient des tripes. Elle m'est tellement proche que ce pourrait être un autoportrait du jeune père que j'étais alors.
Elle est extraite de la série Nationale 7. Je l'ai faite en juillet 2000 dans le No Man's Land zone commerciale autour de Nevers où je trainais ce soir-là. Il revenait d'un mariage à la tombée de la nuit. Je lui ai demandé de s'arrêter juste avant de traverser la route. Une voiture est passée et l'a légèrement éclairé de ses phares. Leica M6 à main levée, 35 mm à pleine ouverture entre 1/2s et 1/8s, je ne sais plus. Négatif couleur numérisé, et vu les conditions de lumière je ne pense pas qu'elle sorte bien en tirage sous agrandisseur. Je n'ai jamais essayé. Comme quoi, le numérique…
Interview : Sandrine Fafet
(Décembre 2013)