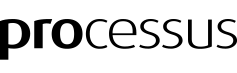INTERVIEW
- Premiers contacts avec la photographie ?
Grégoire Korganow : J'ai fait l'école Estienne à Paris, en arts appliqués. Je voulais devenir… peut-être pas un « artiste » - une notion sans doute trop abstraite - mais je dessinais beaucoup. Il y avait un atelier photo à Estienne, ouvert à tous, et j'ai fait mes premières photos à cette époque, des portraits d’Henriette Nizan, la femme de l’écrivain Paul Nizan. Henriette Nizan est un personnage extraordinaire qui a traversé le siècle. Elle a fréquenté les intellectuels de l'époque qui gravitaient autour de Sartre, Simone de Beauvoir, Aron… Elle a été la maîtresse d'Erich von Stroheim, de Fernand Léger, la doublure à Hollywood d'Ingrid Bergman… Un personnage très romanesque. Je l'ai d'abord dessinée, puis enregistrée et photographiée. Ce fut ma toute première expo. J'avais 21 ans. J'y montrais des photos bien sûr, mais aussi des écrits, des textes qu'elle avait elle-même rédigés, avec une bande-son...
- Une première expo de portraits à 21 ans, et ensuite ? Comment devient-on
photo-journaliste ?
GK : En 1989, il y a eu la chute du mur de Berlin. L'ouverture du bloc de l'Est. J'étais très romantique. J'ai suivi une fille qui partait en Russie, et je suis tombé sous le charme du pays. Mon père m'avait offert un vieux Rolleiflex. Je n'avais pas fait d'école de photo, je découvrais tout en même temps : la photo, le reportage, la vie. Un voyage initiatique. La photo m'a ouvert les portes d'un monde dont j'ignorais complètement l'existence. Tout à coup, j'ai pu vivre une autre vie, une vie plus excitante, à travers la vie des autres, et raconter des histoires.
Quand j'ai commencé, la photo était déjà en crise mais elle permettait un mode de vie génial : tu voyageais, tu photographiais, tu vendais tes images. Bien sûr, il y avait déjà la précarité et l'incertitude, mais tu savais que les photos, tu les publierais. Pas forcément en Une du
New-York Times, mais il y avait une telle masse de journaux qui se procuraient des images à l'époque, que, si ce n'était pas
L'Huma, c'était
Courrier International,
Le Monde Diplomatique,
Libé,
VSD… En 1993, il y a eu les émeutes à la Goutte d'Or. J'étais jeune photographe, exalté. Je suis tout de suite allé sur place faire des photos. Elles ont fait la Une de
Libé. Ensuite tout est allé très vite. Pendant près de dix ans à
Libé je suis devenu monsieur castagne, monsieur exclusion, monsieur banlieue, et j'ai travaillé comme cela pour la presse française et étrangère pendant près de vingt ans. À présent, je ne travaille plus pour la presse. Lorsque j'ai une idée, je la rédige, je cherche des partenariats et je la produis.
- La fameuse transition entre argentique et numérique s'est passée comment pour vous ?
GK : Je dirais que pour moi, le passage au numérique a véritablement eu lieu en 2010, avec mon travail sur la prison.
Je travaillais beaucoup au moyen format. Je suis de cette génération de photographes qui a bossé au Mamiya 7 II, qui a commencé à exploser les formats, à introduire du carré dans le reportage, du 6x7, du panoramique, etc. Très vite, j'ai déserté le 24x36 - format trop marqué. Quand je travaillais pour
Géo, je partais avec un Blad. L'ekta était derrière nous. Même la Kodachrome, j'en ai fait un peu mais très vite on est passé au négatif couleur, à la Portra, avec une souplesse, une liberté de travail incroyables. L'arrivée du numérique ressemblait à un retour en arrière. Avec un D200, on appauvrissait pas mal notre photo. Les boîtiers n'étaient pas encore très performants. On revenait à un procédé hyper contraignant, comme avec la diapo de Papa où au moindre écart de diaph tu explosais les blancs. Et du coup j'ai trainé, j'ai trainé…
Je ne fais pas moi-même le traitement de mes images et j'avais besoin de trouver comment gérer mes fichiers. La série
Père & Fils a été commencée en ekta, au Blad. Après, j'ai fait un peu de nég. Mais quand économiquement cela est vraiment devenu intenable (l'achat des films, les développements, les contacts, les scans, etc.), j'ai dû passer au numérique. Les boîtiers ont beaucoup évolué. Le 5D n'est certes pas le boîtier le plus excitant de la terre (je caresse mon Blad, je ne caresse pas mon 5D), mais si je peux avoir parfois la nostalgie de l'outil, je n'ai plus de problème avec la qualité.
Et puis j'ai rencontré Marie-Laure, et avec Processus, j'ai vraiment pu mettre en place une chaîne qui me satisfait.
- Quels sont les photographes qui vous ont donné envie de faire de la photo ?
GK : Les photographes qui m'ont marqué sont ceux qui m'ont fait voyager. Dorothea Lange parce que ses photos sont comme des romans - j'avais l'impression de voir les films d'Elia Kazan. Brassaï parce qu'il se baladait avec Henri Miller. Don McCullin, pour son engagement, témoin implacable. William Klein, parce qu'il est un peu punk, un peu pop. Depardon, pour cette humilité, et pour la place qu'il laisse au "rien". Avedon, parce que
Visages de l'Ouest est l'un des premiers bouquins que j'ai eu. Ces visages me fascinaient, ils vous emmènent ailleurs. La photo, pour moi, est un champ de fictions. Elle me permet de me raconter des histoires, de rentrer en contact avec le monde, de m'émouvoir, me révolter. C'est une boîte sensorielle. Je ne l'envisage que comme cela.
- Et parmi les plus jeunes ?
GK : Marion Poussier, pour son travail sur les adolescents, que je trouve très beau. Edouard Elias, dont j'avais vu le travail à
Visa pour l'Image, photographe de guerre, ex-otage. J'aime cette génération très romanesque qui affirme que le photo-journalisme n'est pas mort. C'est important.
- Vous vous êtes maintenant plutôt recentré sur des séries personnelles ?
GK : J'ai envie de prendre une page blanche et d'inventer. D'être dans un récit qui n'existe pas a priori, de propulser les gens dans quelque chose, que l'image s'invente, s'écrive en même temps qu'elle se fait. Pour
Prisons, je suis allé dans une réalité spectaculaire, bien sûr, mais les images, je les ai vraiment construites comme un récit. Quand tu rentres dans une cellule qui fait 9 m2, par exemple, tu ne peux pas dire aux trois types qui vivent dedans : "Écoutez les mecs, oubliez-moi, on va faire des photos". C'est tout simplement impossible. Du coup, tu discutes : "Qu'est-ce que l'on pourrait faire, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce que l'on pourrait expliquer…" En trois ans d'immersion, je n'ai pas fait beaucoup d'images. J'ai beaucoup observé, j'ai mis en place un dispositif, que j'ai ensuite laissé évoluer. Et là, je suis déjà presque dans la fiction.
Récemment, on est venu me voir pour un sujet sur le cancer. J'ai eu carte blanche. C'est comme cela que j'aime travailler : réfléchir, rencontrer les gens, conceptualiser. Je mets en place un dispositif et je propulse tout le monde dedans. Ensuite, le dispositif lui-même évolue, chacun s'en empare, réagit, se laisse aller, résiste, et c'est ce jeu-là qui m'intéresse.
- Votre manière d'aborder la photographie a donc changé ?
GK : Si l'on m'avait demandé, il y a dix ou quinze ans, de réaliser des photos dans une maison de retraite, (ce que je fais aujourd'hui avec le soutien du FNAGP), j'y serais probablement allé avec mon appareil photo, tenter de photographier la
vieillesse, la
main, le
regard. Et je me serais appuyé sur ce que je voyais. Aujourd'hui, j'ai proposé une création sur le rêve. Je demande aux pensionnaires de me raconter un rêve. Pas forcement un rêve au sens propre, mais leur rêve. Je l'incarnerai avec eux, puis je le filmerai ou je le photographierai. Pour le projet sur le cancer, j'ai souhaité une période d'immersion : j'ai assisté aux soins, j'ai rencontré les malades, les soignants. J'aurais pu faire des photos comme a fait Martine Franck ou Jean-Louis Courtinat, en essayant de trouver la bonne distance. J'ai plutôt proposé de photographier les malades dans des paysages familiers. Nous avons sillonné la Haute-Normandie et réalisé des prises de vue sur les falaises d'Étretat, des bords de Seine, un bocage, une plage du Havre etc. J'ai invité à chaque fois huit à dix personnes, dans un paysage choisi avec le patient, et j'ai essayé de voir ce qui allait se passer.
Demain je commence un travail que je souhaite au long cours dans un collège. Je ne sais pas encore ce que je vais faire…
- Père & Fils, une suite… ?
GK : Je pars au Brésil, grâce à l'expo de la MEP, poursuivre
Père & Fils. Je vois que cette série intéresse. Aux USA peut-être, en Afrique ? Un livre sort au printemps. Une expo en automne. Cela a commencé comme un travail familial, mon père, mon fils et quelques potes. Je ne pensais pas, en ouvrant cette boîte, que, cinq ans après, je serai encore là à réunir des pères et des fils, en France, à l'étranger. Et je ne m'en lasse pas.
- Et Prisons ?
GK : Je pensais arrêter la série, et puis on m'a contacté pour faire un travail, dans la continuité, sur les familles de détenus. Avec, peut-être, de la vidéo...
- La vidéo, justement, est un domaine qui vous intéresse beaucoup ?
GK : La vidéo représente actuellement 20 % de mon travail. Mais j'aimerais que ce soit davantage. Aujourd'hui, le fait que les photographes fassent aussi de la vidéo est une idée complètement intégrée et le clivage entre photo et vidéo n'a plus aucun sens. Je pense par exemple à l'installation vidéo de Rineke Dijkstra à la fondation Vuitton. Faire un film, c'est autre chose. Pour l'instant, je fais des installations vidéo, des petits modules, de la restitution. Mais je souhaite faire de la fiction. L'écriture cinématographique, cela s'apprend. J'apprends. J'apprends à me familiariser avec le récit, avec le mouvement. Je commence à diriger (ce que je ne faisais pas avant). Je fais les castings, je mets en scène des gens. Pas à pas, je me dirige vers la réalisation pure et simple, ce qui n'exclut pas de continuer la photographie.
- L'écriture occupe également une place très importante dans votre travail ?
GK
: Oui, je puise beaucoup dans l’écrit. Ce n'est pas le déclencheur d’une photo, mais c'est une discipline qui me nourrit énormément.
- On ne peut donc plus être simplement photographe…?
GK : Ce que je sais faire, en tout cas, c'est embarquer les gens dans mes histoires. Je sais que je peux gérer un groupe de dix personnes qui n'ont jamais été photographiées, qui n'ont aucun lien avec la création artistique, qui sont même assez exclues du champ de la représentation sociale, des gens à qui on ne s'intéresse pas beaucoup. Et je sais que je suis capable de leur faire enlever leurs pompes, remonter leur pantalon, et rentrer dans une rivière, fermer les yeux et écouter le vent. Par exemple. Cela ne fera pas une bonne photo obligatoirement, il va se passer quelque chose - ou pas, mais en tout cas, cet exercice-là, je sais le faire. Quand je fais des photos, j'ai envie de tirer les gens vers le haut. J'ai envie de les amener à trouver une espèce de moment de grâce que seule l'image permet. Je suis très optimiste quand je photographie.
QUESTIONS SUBSIDIAIRES
- Quel (autre) métier auriez-vous aimé faire ?
GK : Rock star.
- Quel métier n'auriez-vous pas aimé faire ?
GK : Militaire.
- Qu’est-ce qui vous fait réagir le plus de façon créative, spirituellement, ou émotionnellement ?
GK : La gentillesse.
- Qu’est-ce qui, au contraire, vous met complètement à plat ?
GK : La méchanceté.
- Quel bruit, quel son, aimez-vous faire ?
GK : Faire tourner ma moto...
- Quel bruit détestez-vous entendre ?
GK : Les pleurs.
- Quelle est votre drogue favorite ?
GK : La musique.
- Quel don de la nature aimeriez-vous posséder ?
GK : Le chant.
- Quel est votre juron, gros mot, blasphème favori ?
GK : "
Putain-merde-fait-chier".
- Qui aimeriez-vous shooter pour mettre sur un nouveau billet de banque ?
GK : Bonnot (même s'il est mort).
- Quelle est l’activité qui vous permet de reposer vos yeux et de ressourcer votre envie de photographier ?
GK : La course.
- En quoi aimeriez-vous être réincarné ?
GK : En femme.
- Avez-vous un objet fétiche, un porte-bonheur ?
GK : La montre de mon père.
SI VOUS ÉTIEZ
- Une couleur ?
GK : Le noir.
- Une chanson ?
GK : "
Mon fils, ma bataille" (bien sûr).
- Un objet ?
GK : Non, cela me déprimerait d'être un objet...
- Un(e) artiste ?
GK : Picasso.
- Une œuvre d’art ?
GK : "
Guernica".
- Un alcool ?
GK
: Du rhum.
- Un sentiment ?
GK : L'exaltation.
UN PHOTOGRAPHE + UN LABO
Grégoire Korganow & Processus
- Pourquoi avez-vous choisi Processus ?
GK : Je connais Processus et Marie-Laure depuis le début. Mais on s'était toujours raté, de peu. Et lorsque tu te rates plusieurs fois, tu as l'impression que la rencontre ne sera peut-être plus possible… Et puis, il y a eu
Prisons. J'avais besoin de quelqu'un pour travailler sur mes images et je cherchais un chromiste indépendant, parce qu'il est très difficile d'avoir un traitement personnalisé dans les labo. Ils n'ont pas le temps. J'ai demandé à Jérôme Bonnet - avec qui je suis ami, s'il avait un conseil et il m'a recommandé Processus. On s'est rencontré et tout a marché. J'ai trouvé un labo qui est à mon écoute. Pas besoin d'être tout le temps présent, ils comprennent ce que je cherche. Le travail de Processus est vraiment ce qui a été fait de plus beau pour moi !
Interview : Sandrine Fafet
(Septembre 2015)