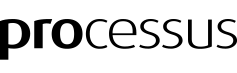INTERVIEW
- Premiers contacts avec la photographie ?
Bruno Boudjelal : L'élément déclencheur, c'est un accident, c'est l'Algérie, et mon premier voyage là-bas en 1993. Au départ, je n’ai pas l’intention d’être photographe. J’aime beaucoup lire, j’aime beaucoup le cinéma, (le ciné-club du lycée, le film du dimanche soir...). En 93, je connaissais davantage Antonioni, Tarkovski, et Cassavetes que Robert Frank, ou Cartier-Bresson.
- Comment êtes-vous devenu photographe ?
BB : Je suis parti en Algérie en 1993 à la recherche de ma famille (famille paternelle : mon père est algérien, ma mère française). Et je n'avais absolument rien à voir avec le métier de la photo.
Quelques jours seulement avant mon départ, un ami me dit : « Tu vas en Algérie, tu devrais faire des photos. » Il me propose de me prêter son appareil (et doit même me préciser qu'il faut mettre des films dedans - je n'y connais vraiment rien). Par le plus grand des hasards, trois semaines auparavant, j'accompagne des amis voir une expo de Salgado sur l'Amérique Latine (je n'allais jamais voir d'expo photo par ailleurs). Et donc, au moment de choisir mes films, je me rappelle cette expo, je me dis que la grande photo doit être en N&B et je pars avec huit bobines N&B que me donne mon ami.
Et tout a commencé comme cela. Ni formation, ni référence. J'avais 33 ans. Rien ne me prédestinait à ce métier (mais il n'y a peut-être pas de hasard) et tout est lié à cette histoire familiale, à ce voyage en Algérie.
- Vous devenez donc photographe sur le terrain, à travers cette quête de vos
origines ?
BB : À peine arrivé en Algérie, on me demande ce que je viens faire là. Expliquer que je viens rechercher une part de moi-même ici, et une famille - dont je ne sais rien - me paraissant un peu compliqué, je prétends simplement que je suis photographe. Et lorsque l'on me met en garde sur les dangers de l'entreprise (le pays est en pleine guerre civile à l'époque), j'affirme que j'ai l'habitude. Ce qui est totalement faux. J'étais guide en Asie du Sud-Est, je travaillais pour Terres d'Aventure et j'emmenais des voyageurs faire du trekking en Birmanie, Laos, Vietnam et Chine. Là-bas, je ne faisais pas de photos. Ce que j'aimais, c'était voyager, mais voyager sans faire de photos.
La situation en Algérie dans ces années-là était vraiment très difficile, c'était le chaos, attentats, assassinats, etc. Dès le premier jour, je me fais agresser et arracher le viseur de mon Nikon. Le soir même, un peu embarrassé, j'annonce l'incident à mon ami en pensant que je ne pourrai plus faire de photo… mais j'ai tout simplement continué - sans viseur.
Je reviens en France avec six ou sept bobines. Sans en attendre quoi que ce soit.
- Quête d'identité, journal photographique, regard documentaire : ce voyage intime a finalement su toucher tout de suite la presse et le monde de la photo ?
BB : À mon retour, l'ami en question - ancien icono de L'Autre Journal, très sensible à la photo - me demande si j'ai fait des films. Il me conseille de faire des planches-contact et puis, en les voyant, de les montrer à d'autres professionnels, mais je n'ai personne à qui m'adresser. Il me donne alors le contact d'une amie à lui qui travaille dans la photo.
J'appelle cette femme. Elle me dit qu'elle n'a pas le temps de me recevoir, je lui dis simplement : « Je ne vous demande rien. Mon ami m'a demandé de vous appeler, il a jugé intéressant pour vous de voir ces images, ni plus ni moins » et elle accepte un rendez-vous dans un café, en me prévenant qu'elle ne pourra rien faire pour moi : « D'accord. Mais vous voulez voir les images ou pas ? » Elle regarde les planches et puis, assez directive, elle me dit : « Sortez une feuille de papier. Notez. À Libé, vous appelez telle personne de ma part, Le Monde, vous appelez telle personne, Le Monde Diplomatique, telle personne. » Et elle s'en va. Je contacte Libé. Libé publie une double page. Je vais voir Le Monde, ils éditent une photo. Je vais voir Le Monde Diplo, j'obtiens un portfolio, et L'Événement du Jeudi sort également un portfolio. De là, L'Observer (un journal anglais) voit mon travail, m'appelle, et sort un portfolio...
- Vous ne vous attendiez sans doute pas à une telle réception ?
BB : Pas du tout. J'obtiens, pour un nouveau projet, une bourse de 100 000 francs avec les uniques vingt cinq images rapportées de ce tout premier voyage en Algérie.
Mais cela ne fait pas de moi un photographe. Avant de repartir, j'achète le livre de Salgado sur l'Amérique du Sud, et tout en le feuilletant, je tente de me persuader que je vais y arriver… !
- Ce sera une série sur la communauté turque à Bordeaux, suivie d'une expo en 1994 : Gurbet, Turcs d'ici
BB : Une toute petite expo : quinze tirages, avec des cadres achetés à Ikea, exposés dans les sous-sols de l'association Elele. Le soir du vernissage, un grand gars vient me voir, il me tape dans le dos et me félicite pour mon travail. Il me donne sa carte. C'était Göksin Sipahioglu, photo-reporter turc et fondateur de l'Agence SIPA PRESS.
- Vous intégrez donc ainsi l'Agence SIPA ?
BB : Ils me ménagent et ne me font pas faire le people. Je suis à l’illustration ; sur l’aéroport de Roissy, la douane, la police, les transports, etc. Mais je sens que je ne suis pas à ma place et je quitte l'agence après quelques mois. Göksin Sipahioglu me laisse partir en me prédisant que j'ai tort. Je rencontre alors par hasard le directeur de Terres d’Aventure dans un café, qui me propose de repartir en Birmanie pour eux. Je pars habiter à Bangkok et j’arrête complètement la photo.
Et puis je me casse le poignet, je suis obligé de rentrer en France. Au printemps, je discute avec mon père et - je ne saurais plus dire comment, on décide de faire un voyage en Algérie, ensemble, dans ce pays qu'il a quitté au milieu des années 50, et qu'il a toujours tenté de gommer, de me cacher, d'oublier.
On fera deux voyages ensemble : le premier en juillet 97 et le second en novembre, où mon père fera une grande fête pour célébrer les retrouvailles. Avant de partir, la question se pose d'emporter ou non un appareil photo. Quelque chose me pousse à le faire. En N&B, toujours. Je fais des images des deux voyages de mon père. Pourquoi je fais ces images ? Je ne le sais pas, en tout cas, je le fais. À mon retour, Sophie Rebbot, directrice du service photo du magazine Géo, me contacte et insiste pour voir ces images - que je n'ai toujours pas fait développer. Au regard des planches-contact, ils décident, avec Jean-Luc Marty, le directeur en chef de Géo, de publier les deux voyages. Ce que je ne pouvais pas savoir, c’est qu'ils préparaient pour le printemps 98 un numéro spécial sur l’Algérie…
Et puis Kathy Ryan, pictures editor du New York Times magazine, qui a vu passer le portfolio dans Géo, me contacte pour un portfolio dans le New York Times. Ensuite ce sera Stern, El Païs, Independant, La Stampa… Je sais qu'il faut que je poursuivre l’histoire avec l’Algérie.
- Vous entrez ensuite à l'agence VU' ?
BB : Après ces deux voyages en 1997, j'obtiens une nouvelle bourse (dont le rapporteur est Christian Caujolle) pour continuer le travail sur l'Algérie. À la fin du projet, Caujolle revient évaluer le travail que j’ai produit. La veille, je suis avec des amis et, ensemble, on décide de monter un collectif. Le lendemain, Caujolle me propose d’entrer à l’agence VU' : je me sens obligé de refuser. Quelques années plus tard, je rencontre à nouveau Caujolle à l'exposition de mon ami Antoine D’Agata. On déjeune ensemble le lendemain, et j’entre à l’agence VU'.
- Et le passage du N&B à la couleur ?
BB : J’intègre l’agence VU' vers juin 2001, et quelques mois plus tard, ils pensent avoir trouvé la poule aux oeufs d’or pour aller en Algérie : j’ai la double nationalité, je peux m'y rendre sans visa. On m'obtient facilement des garanties auprès de nombreux journaux, Paris Match, VSD, etc. Juste avant mon départ, la responsable de la presse française vérifie simplement que je travaille bien en couleur. Alors je mens : « La couleur ? Bien sûr, pas de problème »...
À mon retour, j'ai rendez-vous avec le directeur de la photo de Paris Match, il regarde mes images, mais mon travail ne correspond pas du tout à ce qu'il pouvait attendre d'un reporter ; je ne suis plus jamais reparti avec de telles garanties. Mais j’avais commencé la couleur. Et je n'ai fait que de la couleur par la suite.
- Rencontres, hasards, accidents, la traversée d'un pays en pleine guerre civile, c'est dans ce contexte particulier que votre langage photographique s'est mis en place
BB : En Algérie, j’ai vite abandonné les Leica, et autres vrais boîtiers de qualité. Je l'ai dit, premier jour à Alger en 93 : je me fais agresser, le viseur de mon Nikon est arraché. À mon deuxième voyage, la question se pose : est-ce que je continue à photographier ? Le territoire est tellement hostile - en dehors de l'espace intime de la famille qui lui est ouvert, partout ailleurs, sortir un appareil photo, est réellement dangereux. Alors je suis reparti avec des appareils photo en plastique, et même des jouets, mais pas parce que je voulais donner une forme particulière à mes images. À l'agence VU', il y a des photographes qui ont pu adopter cet aspect formel par choix, pour ajouter du sens à leur photographie. Moi, pas. Seulement, chaque fois que l’on m’a contrôlé au check point, à la gendarmerie, au poste de sécurité militaire, jamais aucune force de l'ordre n'a pu imaginer que je faisais quoi que soit avec ce matériel.
Dans la casbah, si vous donnez l'impression de savoir où vous allez, vous passez. Mais si vous commencez à flâner, c'est dangereux. Mes images sont parfois floues, tremblées, bougées et les sujets décadrés, décentrés, parce que, pour rester discret, il faut rester en mouvement, aller vite, ne pas réfléchir, ne pas hésiter. Si je photographie souvent derrière une vitre, c'est aussi parce que, dehors, j'ai peur, tout simplement. Et cela a du sens. Je n'ai pas trouvé d'autres moyens de photographier l'Algérie durant la guerre civile. Est-ce un échec ? Quoi qu'il en soit, j'y vois mes limites. Ce langage photographique-là reste donc le seul que j'ai été capable de trouver.
- Vous n'en aviez pas terminé avec l'Algérie, cette culture, avec cette quête de vos racines ?
BB : En 93, je voulais découvrir l’Algérie, cette terre où est né mon père mais dont je ne savais rien : après une journée à Alger, j’ai vite compris que je n’allais rien découvrir du tout de l’Algérie. Le pays était trop dangereux. Mais l’envie de le faire était toujours présente. En 2003, la situation s’était apaisée ; je décide de faire une traversée de l’Algérie d’Est en Ouest. Il faut trouver de l’argent. J’appelle Jean-Luc Marty, le rédacteur en chef de Géo. Je n’ai pas du tout le profil pour travailler à Géo mais je dis que je cherche de l’argent pour continuer. Il me répond : « Ok, vas-y » J'ai carte blanche pour faire ma traversée de l’Algérie, de la frontière Tunisienne à la frontière du Maroc.
Durant ce voyage, deux choses s'imposent. Je sens que c’est la fin de ce travail commencé en 93, qui est marqué par ma quête d’identité, le retour de mon père au pays, la famille, les retrouvailles avec nos racines, nos origines. Et puis, ce qui me perturbe, c’est le fait que, tandis que je parcours de nombreuses régions (les premières années, le pays est dangereux, mon travail est très circonscrit dans l’espace - là où j’ai de la famille et Alger, là où j’ai un ou deux amis, c’est tout. En 2003, je peux circuler plus librement) je ressens comme une familiarité, une proximité avec des lieux où je n’étais pourtant encore jamais allé : je me demande alors si, en dehors du lien familial, il pourrait exister un lien autre, lié à ce territoire, à ce pays, où demeure une partie de moi-même ?
Et 2003 se termine comme cela, sur ce constat et à partir de ce moment, j’arrête la photographie en Algérie. J’y retourne, mais uniquement pour voir la famille.
- Jours Intranquilles, 1993-2003 est achevé, vous tournez une page
BB : Et entre 2004 et 2010, je pars sur un nouveau projet. Encore une histoire de rencontres. L'été à Arles, je me retrouve à discuter de mon avenir avec mon amie Florence Aubenas. Il est question d'un éventuel projet sur l'Afrique, une traversée de Tanger jusqu'au Cap. Elle me conseille de déposer ce projet à Libé : six mois plus tard, Libé me contacte et m'alloue 15000€ - à l'époque c'est énorme - pour faire ce voyage. J'ai carte blanche. Juste avant mon départ, aux Puces, je me laisse convaincre, par hasard, d'acheter un petit appareil format 120, de type Olga, et je décide de l'emporter avec moi. Je le charge en N&B.
Et c’est là, au Ghana, dans le village de Kwame Nkrumah, (premier président du Ghana et père du panafricanisme) que je recommence le N&B. Raconter cette histoire en couleur ne me semblait pas possible et je sors une série, format carré, en N&B.
Ensuite en 2009, et jusqu’en 2013, je referai un travail sur l'Algérie (Algérie, clos comme on ferme un livre ?)...
- Et toujours en argentique ?
BB : L’argentique, c’est de l’argentique, le numérique, c’est du numérique. Maintenant que de grands photographes font aussi de grandes choses en numérique, pourquoi n’y aurait-il pas la place pour les deux ? Je suis vraiment un amoureux du film, du grain. J’ai appris le développement et le tirage classique, tirage au charbon, à la gomme bichromatée, tirage platine, etc. - ce que je n'ai plus le temps de faire - mais je reste très attaché à ces techniques.
L’argentique vous installe dans une échelle de temps qui est très différente en numérique. Il n’y a pas cette immédiateté. Je suis du genre à laisser dormir les films longtemps avant de les porter au labo pour les développer. Je n’ai pas cette urgence de revenir de quelque part et de vouloir voir tout de suite, à tout prix, ce que j’ai fait. La notion de temps a changé. Le numérique, je pense que ce n’est pas mon histoire.
QUESTIONS SUBSIDIAIRES
- Quel (autre) métier auriez-vous aimé faire ?
BB : Psychanalyste, ou architecte.
- Quel métier n'auriez-vous pas aimé faire ?
BB : Militaire.
- Quelle est votre drogue favorite ?
BB : Le cinéma.
- Qu’est-ce qui vous fait réagir le plus de façon créative, spirituellement, ou émotionnellement ?
BB : L'amitié.
- Qu’est-ce qui, au contraire, vous met complètement à plat ?
BB : L'injustice.
- Quel bruit détestez-vous entendre ?
BB : Celui des armes.
- Qui aimeriez-vous shooter pour mettre sur un nouveau billet de banque ?
BB : Personne... ce n'est pas rendre service à quelqu'un !
- Quel est votre juron, gros mot, blasphème favori ?
BB : « Narvalo ».
- Quel don de la nature aimeriez-vous posséder ?
BB : L'ubiquité.
- À quoi sert un photographe ?
BB : Plus que les photographes, ce sont des artistes comme Anselm Kiefer, Mark Rothko, Christian Boltanski, ou Gerhard Richter, qui vont me toucher. Je n'arrive pas à éprouver les mêmes émotions, en photos, qu'en écoutant de la musique, ou qu'avec certains films, comme par exemple Meurtre d'un bookmaker chinois, de John Cassavetes. Diane Arbus ou Richard Avedon m'impressionnent, c'est certain, mais je ressens peut-être davantage d'émotions en littérature et en peinture.
- Avez-vous un objet fétiche, un porte-bonheur ?
BB : Ma première femme était portugaise, et ses parents, desquels j'étais très proche, m'ont un jour donné une petite médaille avec une sainte gravée dessus, en me disant : « Quand tu voyages, il faut que tu la prennes avec toi ». Et je m'aperçois qu'aujourd'hui encore, elle est là, avec moi.
- En quoi aimeriez-vous être réincarné ?
BB : En ce que j'étais… pour essayer de faire mieux.
- À quoi vous sert l’art ?
BB : À vivre.
SI VOUS ÉTIEZ
- Une couleur ?
BB : Rouge.
- Une chanson ?
BB : « Que reste-t-il de nos amours ? » de Charles Trenet
- Un objet ?
BB : Un galet.
- Un animal ?
BB : Un chat.
- Un alcool ?
BB : La vodka.
- Une œuvre d’art ?
BB : Les trois Bleus de Joan Miro.
L'ARRÊT SUR IMAGE de Bruno Boudjelal
Algérie, clos comme on ferme un livre ? 2009 - 2013 (Dounia à la balançoire)
BB : Il s'agit du dernier travail que j'ai réalisé sur l'Algérie. On y voit la fille d'un ami, Dounia. L'image a été prise à Chlef - anciennement Orléansville - une ville rasée au trois quart par un tremblement de terre dans les années 80. Située dans une zone particulièrement touchée par le terrorisme dans ces années-là, elle est devenue l'un des hauts lieux du terrorisme et des massacres dans les années 90.
C'est un endroit où je n’étais encore jamais allé. Dans certaines régions, en Algérie, pendant dix ans, il y a eu les ténèbres. Et maintenant encore, quinze ans après, vous pouvez avoir l'impression que la bête n’est pas très loin (peut-être un fantasme de ma part ?). Ce qui me touche sur cette image, c’est que je suis justement là dans l'un de ces lieux plombés par l'Histoire, par toutes les horreurs qui ont pu s'y passer, et où les gens eux aussi sont plombés par le passé. Et puis soudain, a eu lieu quelque chose d'assez fort - rien d'extraordinaire - quand la fille de mon ami, Dounia, qui s'ennuyait, est montée sur la balançoire de la cour et qu'elle s’est mise à rire. Quand j'ai vu l'image sur la planche contact, j'ai réalisé que, si inquiétantes soient-elles, ces terres hostiles pouvaient être elles aussi traversées par la lumière. Ce n'est pas un message d'espoir. Mais c'est un moment très touchant.
Les paysages du départ, 2009 - 2013
BB : Un accident, une fois de plus. Je veux photographier les lieux d'où partent les
Harraga, ces migrants clandestins qui traversent la Méditerranée, entassés sur des embarcations de fortune, pour atteindre l'Espagne ou l'Italie. Je demande à un ami écrivain et journaliste de m'y conduire. Nous parcourrons des plages, sans rien d'extraordinaire. Et comme souvent, ici, je travaille avec un jouet, un de ces appareils en plastique où la qualité de la lentille est tellement mauvaise que si vous ne surexposez pas énormément le film, vous n'obtenez rien.
Je charge un film en N&B, Ilford 3200 - à 9000 asa. C'était une de ces belles journées ensoleillées d'Algérie, avec une lumière très blanche, très dure. On s'arrête (la plage s'appelle Madrid). Je cherche juste à photographier les gens. Les lieux d'où l'on part. Je fais trois films. Je reviens en France. Je passe chez Processus, je donne à développer les films de l'ensemble de ce voyage. Et puis le labo me prévient que trois des films seront vraiment trop sur-exposés pour être exploités. Je ne veux pas renoncer. J’essaye de les scanner moi-même, et bien sûr je n'en sors rien. Je demande à un ami de tenter d'en tirer quand même quelque chose, avec un bon scanner.
Et c'est de là qu'est née cette série. Vient alors l'idée de questionner ces paysages, et d’imaginer lorsque, dos à la mer, on s'éloigne, lentement, vers le large : que reste-t-il d'un pays que l'on quitte - la dernière image physique ? Cela m'a fait parler de l'effacement, de la disparition, et du souvenir.
Ce qui est étonnant, c'est que j'ai présenté cette série au musée Niepce. Le lendemain, il y avait une réunion avec le public. Deux personnes viennent me voir. Les jeunes qui partent, en laissant tout derrière eux, on les appelle des harraga, ce qui veut dire "brûleurs", ceux qui brûlent la route, les frontières, brûlent leurs papiers, et brûlent la vie pour partir. Un vieux chibani (ces vieux travailleurs algériens qui n'ont jamais fait venir leur famille en France, qui sont restés seuls, parfois en foyer ou ailleurs, et qui, au moment de la retraite, pensent qu'ils vont retourner en Algérie mais qui finalement restent pour toujours ici, dans un entre-deux) un vieux chibani, donc, me demande de lui expliquer ces images, qu’il ne comprend pas. Il m’écoute, et me dit que, moi aussi je suis un harrag, parce que j’ai « brûlé le papier ».
Et puis un autre homme arrive, un homme d'origine asiatique, les larmes aux yeux. Il demande à me parler à part. Je pense qu'il a une histoire avec l'Algérie. Pas du tout : « Je suis malgache, me dit-il, et il y a cinquante ans, je suis parti de Madagascar en bateau. On voyait les cotes s'éloigner. Et j'ai le souvenir que, d'un coup, tout est devenu blanc. Exactement comme ça. D’être confronté à nouveau à tout ça, c'est très dur… »
Interview : Sandrine Fafet
(Décembre 2015)