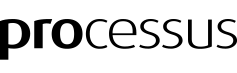INTERVIEW
- Premier contact avec la photographie ?
Anton Renborg : J’ai été musicien dix ans dans un groupe - guitare et chant. Entre 15 et 25 ans, mon rêve, c'était la musique ; je ne rêvais pas d'être photographe. Mais fédérer un groupe demande beaucoup d'énergie, gérer les autres musiciens, maintenir la cohésion, trouver des contacts, prendre des rendez-vous. Internet n'existait pas, il fallait produire des cassettes, et les faire distribuer, se faire connaître. Je travaillais très dur. C'est par la musique que j'ai découvert la photographie. On faisait des photos du groupe et des vidéos, je participais à tous les éditings avec le régisseur, j'étais très présent. Quand j'en ai eu marre de me battre et de tout porter tout seul, j'ai réalisé que la photo et la musique fonctionnaient un peu pareil, une question de feeling, d'état d'âme. J'ai commencé à essayer de travailler en photo, autour de la musique, pour des labels. Et pendant un an, dans une petite île en Suède, j'ai fait une école photo, documentaire et reportage.
- La musique reste une seconde passion ?
AR : Quand j’ai complètement arrêté la musique, j’ai revendu tous mes instruments, tout mon matériel. Et je ne voulais plus aller voir aucun concert non plus. La musique, c'est comme une drogue. J'étais enfermé dans une bulle. J'ai même failli perdre ma femme et mes enfants, à être trop replié sur moi-même. La photographie, c'est plus léger. Pas besoin de se couper du monde. Aujourd'hui j’écoute beaucoup de musique, mais je reste à distance de cet univers-là.
- Vous avez commencé votre carrière de photographe avec le reportage. Aujourd'hui, vous faites aussi de la mode, du portrait, etc.
AR : J'ai toujours aimé voyager et à l’époque, comme je faisais du snowboard et du surf, j’avais déjà parcouru la Californie, le Mexique, l'Indonésie, etc. J’avais en tête des tas d'histoires à raconter : j’ai fait mon premier reportage sur Gran Canaria - parce qu’il y a beaucoup de Suédois sur cette île. Elle se divise en deux zones. D'un côté on ne voit que des touristes, partout, et de l'autre, personne ne parle anglais, on ne croise plus aucun étranger. Ce premier reportage s’appelait « Les mondes séparés » et il s’est vendu au plus grand journal de voyage en Suède. C’était mon premier job. J’avais 23 ans.
Et puis je n’aime pas les catégories, je n'aime pas être étiqueté
stylelife,
fashion,
documentaire… C'est très difficile à défendre, parce que les gens ont besoin de te ranger dans une case. Et moi, je déteste les cases. Je fais du reportage, de la mode, du portrait, un mélange de tout cela, parce que, ce que j’adore par dessous tout, c'est que chaque jour soit différent. Mes commandes autant que mes projets personnels, sont une expression de moi-même, quels qu'ils soient.
- Argentique vs numérique ?
AR : J’ai commencé ma carrière de photographe en argentique. Je développais mes films moi-même, et je faisais des tirages dans un labo installé dans ma salle de bain ou dans ma cave. Aujourd’hui, cette expérience influence encore beaucoup ma façon de travailler les images. Je recherche un rendu doux. À l'époque, j’utilisais des liquides de développement très vieux, des temps de développement longs, avec des températures pas trop hautes pour obtenir des noirs jamais vraiment noirs et des blancs jamais blancs.
Et puis Canon a sorti un boîtier numérique pro que j'ai testé. Le livre
Notices de la Corse, par exemple, a été commencé en argentique entre 2005 et 2006, et achevé en 2007 en numérique. Pour alléger le budget, au départ, et aussi pour voir si on pouvait obtenir des fichiers aussi riches qu’un négatif. À présent, je suis passé entièrement au numérique, mais je suis heureux de faire partie de cette génération qui a travaillé avec des films une dizaine d’année, de connaître le grain, etc. J'essaye de travailler encore maintenant comme si j’avais un boîtier argentique entre les mains, de ne pas prendre trop d’images. C'est si facile de shooter quinze images avant qu'il ne se passe quelque chose, et quinze images juste après, pour être bien certain d'avoir la bonne image. Avec l’argentique, il fallait être précis. Tu regardes tes contacts aujourd’hui et tu vois que tout était bon. J'essaye de garder cette démarche en mémoire.
- Résidence à Vichy : Daysinvichy. Vous achevez une belle série sur la ville. Comment s'est monté ce projet ?
AR : J’ai été invité à passer quatre semaines en résidence à Vichy pour le festival de photographies Portrait(s) 2016. J’adore les petites villes un peu perdues et Vichy est comme une ville abandonnée à côté de la mer. Je suis moi-même né dans une petite ville en Suède qu'étant jeune je rêvais de quitter. Mais Vichy est au milieu de la France, et j'y ai retrouvé cet esprit que j'aime tant ici. Il ne s'y passe pas grand-chose, mais dès que tu parles avec les habitants, que tu fais des recherches sur le passé de la ville, tu comprends mieux, tu observes comment s'habillent les gens, et leur manière de vivre, et tu t'aperçois que le goût de la Belle Époque existe toujours. Mais il faut vraiment chercher, gratter la surface, les façades. Ce sont des investigations, vraiment. Je suis allé dans des bars, dans des clubs, des restaurants, des salles de répétition de ballets, j'ai parlé avec des gardiens d'immeuble, je suis entré partout.
Durant la Belle Époque, au début du siècle dernier, Vichy était une station thermale en plein essor. On y avait bâti l'un des plus grands casinos, un opéra. Les gens riches du monde entier s'y retrouvaient dans les hôtels particuliers et les palaces. On allait au spectacle, on faisait la fête. Sur les photos des années 1900 - 1930, tu vois des gens très élégants vêtus de blancs se promener dans des parcs immenses aménagés spécialement pour les curistes. On y buvait l’eau de source matin et soir, et dans la journée, c’était l’absinthe. Avec la seconde guerre mondiale, Vichy a eu mauvaise réputation. Les gens ont trouvé d’autres lieux pour faire des cures et jouer au casino. Aujourd’hui, c'est le passé. La vie nocturne existe encore, mais ce n’est plus haut de gamme. Vichy est une petite ville qui vit toujours de ses rêves, et les rêves sont passés. Quand tu te promènes à bicyclette, que tu vas de quartier en quartier, c’est très vide. On sent que cette Belle Époque leur manque. Mais il reste toujours un petit quelque chose de cet esprit. Quand il y a de grands spectacles organisés, des courses, des ballets, tu vois encore les anciens habillés comme à la Belle Époque. Moi, j’ai recherché cette ambiance et je l’ai retrouvée, ces liens entre les gens, ces vibrations. J'ai vécu une très belle expérience. Le livre
Daysinvichy, sortira en juin et on peut le pré-commander dès à présent sur le site des éditions Filigranes.
- Vous êtes suédois, et vous travaillez beaucoup en France, c'est très important pour vous ?
AR : Si je n’avais pas eu la chance de voyager autant, je serais mort en Suède ! J’ai déjà passé un an à Paris avec ma famille, et je travaille davantage en France qu'en Suède, même si je travaille aussi beaucoup là-bas. Cette année, nous sommes retournés en Suède mais, pour mon travail, je fais beaucoup d'aller-retour. C'est une solution que j'aime bien, aussi, pour le moment. Il y a deux têtes qui travaillent, cela permet d'avoir du recul sur les choses. Ici, en France, c’est le shopping, les apéros, les contacts, les rendez-vous avec les clients autour d'un café, les rendez-vous au labo Processus, etc. En Suède, c’est plutôt mon usine, c’est très carré, je travaille de 8h à 18h chaque jour. Cette discipline est importante parfois, mais la manière de vivre en Suède me tue. Nous les Suédois, nous sommes gentils. On est restés neutres pendant les guerres, notre modèle social a l'image d'un modèle de réussite, mais ce n'est pas une réalité. On est assez fermés, on vit beaucoup en repli à la maison. Ce n’est pas comme ici en France, où je trouve les gens très ouverts. En Suède, c’est un peu froid, comme le climat.
Quand j’ai eu mon premier enfant, j’ai dit à ma femme qu’il fallait que l’on quitte la Suède. On a loué une maison en France, à Menton, pendant huit mois. Mon grand-père et le grand-père de mon père travaillaient en France et ont passé leur retraite dans cette ville, dans cette maison de famille que nous n'avons plus à présent. J’avais installé mon laboratoire dans la cave. Et j’ai shooté cet esprit, comme à Vichy, souvenir d'une époque où des stars comme Greta Garbo venaient se cacher des spotlights d’Hollywood dans les années 1930. On venait aussi en cure à Menton, pour se soigner du choléra. On préconisait un séjour entre les montagnes et la mer, pour respirer. Les cimetières sont remplis de malades morts du choléra qui venaient là pour faire des cures. Exactement comme à Vichy. Moi j’ai shooté la dernière génération mentonnaise, la vieille dame, avec son petit chien, qui fait sa promenade le matin au soleil.
- Prochaine étape ?
AR : Partir en Côte d’Ivoire, pourquoi pas, découvrir l'Afrique et réaliser un projet là-bas. C'est l'une des forces de ma famille : j'ai une femme et trois enfants, et je peux les planter n’importe où, ils trouveront toujours leur chemin. L'année dernière nous étions à Paris. Nous sommes à nouveau en Suède pour le moment. C'est un peu comme si, à chaque projet, on enregistrait un nouvel album : on se demande simplement quel studio choisir…
QUESTIONS SUBSIDIAIRES
- Quel (autre) métier auriez-vous aimé faire ?
AR : Musicien...
- Quel métier n'auriez-vous pas aimé faire ?
AR : Un métier dans lequel tous les jours seraient les mêmes.
- Quelle est votre drogue favorite ?
AR : Ma femme et mes trois enfants.
- Qu’est-ce qui vous fait réagir le plus de façon créative, spirituellement, ou émotionnellement ?
AR : La boxe Thaï et la méditation.
- Qu’est-ce qui, au contraire, vous met complètement à plat ?
AR : La suède.
- Quel est votre juron, gros mot, blasphème favori ?
AR : "Fan i helvete djävla skit".
- Quel don de la nature aimeriez-vous posséder ?
AR : La puissance d'une vague.
SI VOUS ÉTIEZ
- Une couleur ?
AR : Le bleu.
- Un objet ?
AR : Un bateau.
- Une saison ?
AR : La fin de l'été.
- Une chanson ?
AR : Un morceau de SCH.
- Un(e) artiste ?
AR : Van Gogh.
- Une œuvre d’art ?
AR :
Le Cri, d'Edvard Munch.
UN PHOTOGRAPHE + UN LABO
Anton Renborg & Processus
- Pourquoi avez-vous choisi Processus ?
AR : Chez Processus, tu te sens un peu comme à la maison. L’équipe est à la fois très sympa et très professionnelle. Dans d’autres labo, tu sens souvent que chaque minute coûte de l’argent, qu'il y a de la tension dans l’air, que tout le monde est speed, « on a dix minutes pour toi, ok? ». Chez Processus, c’est très cool. Quand tu es engagé à fond dans un projet, tu peux toi-même être un peu stressé. Si les gens autour le sont aussi, on peut craquer. À Processus, tu sens qu’il y a de l’expérience, et que tout est géré de manière détendue.
L’ARRÊT SUR IMAGE d’Anton Renborg
Constantin
AR : L’année dernière nous habitions à Paris et je cherchais un travail pour ma femme, qui voulait participer à une aide humanitaire. J’avais eu le contact de quelqu'un qui travaillait pour une association d'aide aux enfants de Roms, à Montreuil. Je suis allé sur place, dans un camp de Roms. C’est là que j’ai vu ce jeune homme, qui n’était pas comme les autres. Les yeux clairs, il n’était pas vraiment habillé comme un Rom, il était vraiment différent. J'ai tout de suite voulu faire quelque chose avec lui et j’ai demandé si je pouvais avoir son contact, et si je pouvais boire un café avec lui. Il a accepté. On a beaucoup parlé, je lui ai exposé mon projet mais il ne comprenait pas du tout, il ne voyait pas pourquoi je voulais faire quelque chose avec lui, il ne comprenait pas ma démarche. J’ai dormi plusieurs nuits dans le camp, sur un canapé. Et en même temps, à l’époque, je prenais des contacts avec des agences pour des campagnes de pub, deux extrêmes. J’adore les extrêmes. Cela me permet de me calmer. J’ai besoin de toujours garder le contact avec de vrais gens.
Je ne voulais pas montrer l’image des Roms que l’on a déjà tous en tête, l’image du groupe, du camp. Je voulais seulement faire un portrait de lui, Constantin, sans jugement, comme s’il était Italien ou Américain, à la différence que, par hasard, il serait Rom. Je trouvais aussi important pour le camp, pour la famille, pour le groupe, pour les Roms eux-mêmes, de voir l'un des leurs faire autre chose, séparément du groupe. Quand on regarde les Roms, on voit un groupe. Pas des individus.
Il y aura 15 portraits de Constantin sous forme de portfolio, accompagnés d'un texte, les paroles de Constantin que j’ai retranscrites.
Nous, par exemple, on dépose nos enfants à la crèche à 8h, et on revient les chercher à 18h, ils se couchent à 21h. C’est fou, non ? Tu confies tes enfants à des personnes que tu ne connais pas, qui peuvent être des connards de temps en temps. On ne les protège pas. Les enfants Roms sont tout le temps là, parmi les adultes au milieu de la famille, et ils aident aussi dans le camp, à aller chercher du bois, etc. C’est une autre vie.
Les Roms, c’est un sujet classique, mais Constantin est un bon ambassadeur de la cause. Il a été très ouvert, il m'a fait confiance, et on a travaillé librement ensemble. Parfois ce n’était pas très facile de me faire accepter des autres membres du groupe. Le chef du camp m’a interrogé, on m'a insulté de temps en temps : "Tu fais quoi là, putain dégage avec ta caméra". Il y a presque eu des bagarres, aussi, parfois. Il faut savoir rester calme, comprendre que l'on n'a pas le même tempérament, ni la même manière de dire les choses, que c’est une autre manière d’aborder les problèmes, et de prendre les contacts. Ma femme est bosniaque, alors je n’ai pas peur des gens un peu bruts. Et j’ai beaucoup appris là-bas.
Interview : Sandrine Fafet
(Mai 2016)