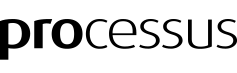INTERVIEW
-
La première série qui vous a fait connaître, « Le Futur du Beau » avait pour thème le recyclage. Comment cette série a-t-elle vu le jour, et comment peut-on devenir « artiste » avec ce genre de thématique ?
Omar Victor Diop : En 2011, l’appel à candidatures des Rencontres de Bamako avait pour thème : « Pour un monde durable ». Les artistes étaient conviés à produire une opinion, un cri du coeur, un constat, sur cette question de la durabilité, sur l’environnement et le recyclage. Je pense que l’intérêt qu’avait suscité ma proposition à l’époque est dû au fait que j’étais moins dans la récrimination que dans la fantaisie. J’ai tout de suite choisi le langage de l’esthétique pour passer un message auquel, finalement, on a fini hélas par être immunisé. Cela fait trente ans que l’on nous informe qu’il ne faut pas polluer, cinquante ans que l’on nous prévient que nous creusons un trou dans la couche d’ozone - tout cela est vrai, et il faut bien sûr continuer d’en parler. Mais peut-être que, ré-inventer le langage pour le dire, et le faire d’une manière poétique, avec un sourire, a permis à cette série de se démarquer des autres propositions. Je possédais au départ cinq ou six images, réalisées spontanément (hors appel à candidatures) qui ont initié la série. Ensuite, lorsque j’ai envisagé de participer aux Rencontres de Bamako, je l’ai complétée et le projet a pris de l’ampleur.
- Lorsque vous avez répondu à l’appel à candidatures des Rencontres de Bamako, vous n’étiez pas vraiment photographe, mais cadre dans une entreprise... Comment ce changement de cap a t-il eu lieu ?
OVD : Un dimanche, j’achète un appareil et je décide de faire des photos - pour moi. Je convie Yacine, une amie d’enfance qui a été mannequin, et l’on tend simplement une grande toile blanche dans mon arrière cour. Je prends les photos. J’avais habillé Yacine avec diverses parures que j’avais confectionnées le soir après le boulot, à partir des déchets de ma propre consommation. Tout y était passé. Du vieux papier kraft à la serpillère, en passant par le sac d’oignons (il est possible que je me sois plus amusé qu’elle !) et j’ai créé cette série, « Le Futur du beau », que je suis très heureux, au départ, de voir simplement imprimée en petit format 13x18 sur ma table, jusqu’à ce qu’un ami photographe - professionnel, artiste, tombe sur ces tirages lors d’une fête que j’avais organisée. Il me dit qu’il faut absolument que je soumette ces images au jury de la Biennale de la Photographie Africaine de Bamako de 2011. Je dis pourquoi pas, puis j’oublie. Finalement l’idée reste, et un beau jour (je crois que c’était vraiment durant les quinze dernières minutes de la dernière journée de la période des candidatures) je décide de filer à l’Institut français pour y déposer mon enveloppe. Et un soir, je reçois un e-mail de Lucie Touya et Michket Krifa, commissaires des Rencontres, qui me félicitent de faire partie de la sélection ! Je n’avais jamais exposé mon travail, je ne l’avais jamais fait imprimer en grand format, c’était tout simplement inattendu. J’ai presque cru à une mauvaise farce. Finalement tout cela était bien vrai.
- De quelle manière êtes-vous passé du monde de l’entreprise à celui de la photographie ?
ODV : La période transitoire n’a pas été simple. Cadre dans la journée, photographe le soir, étudiant en photographie également, par internet. J’ai commencé par faire beaucoup de photographie commerciale, pour me faire les dents : parfois, à l’heure du déjeuner, je fonçais shooter une campagne de pub sur un marché à Dakar et en plein milieu du shoot, je me rendais compte que je ne savais pas activer telle ou telle fonction de mon appareil ! Je devais filer chercher des toilettes, sortir le manuel d’instruction discrètement, trouver la bonne manipulation, finir le shoot et retourner ensuite au travail assister à la réunion de l’après-midi. Une période très fatigante physiquement, et très forte aussi sur le plan émotionnel. C’est en 2012 que j’ai fait le grand saut. J’ai toujours su que j’aurais besoin d’être indépendant, parce que l’entreprise n’était pas faite pour moi, ou peut-être moi pas fait pour l’entreprise. Mais je n’imaginais pas que je deviendrais artiste un jour. J’ai démissionné de mon emploi pour me consacrer entièrement à la photographie en me disant que, si, au bout d’un an, j’en étais réduit à devoir aller manger chez mes parents parce que mon frigo était vide, je serais assez jeune encore pour retrouver un emploi… Heureusement, cela n’est jamais arrivé.
- Tout s’est enchaîné très vite ensuite ?
OVD : J’ai participé aux Rencontres d’Arles six mois après celles de Bamako, en 2012, avec le collectif Afrique In Visu, et à plusieurs autres événements dans différents pays, notamment la Biennale de l’art africain contemporain, le Dak’Art. Et c’est comme cela que je suis devenu très vite photographe « à temps plein ». Ce n’était pas un plan de carrière, où l’on décide par avance de trouver des financements et d’exposer un projet. J’ai commencé la photo pour moi, et j’ai trouvé un public par hasard. Notamment grâce aux réseaux sociaux et au bouche à oreille. Mais c’était totalement imprévu.
J’ai eu la chance de rencontrer des gens qui, dès le début, ont cru en mon travail - avant même peut-être que j’y crois moi-même. Au-delà de tous ces moments de solitude, de doute, qui sont inhérents à la création artistique, il y a aussi eu des concours de circonstance, de la chance, de beaux hasards, et d’heureuses rencontres.
- Qu’est-ce que ces premiers succès ont changé pour vous ?
OVD : Je suis très content des études que mes parents m’ont (lourdement) encouragé à faire, mais j’étais aussi assez déçu de ne pas avoir eu l’opportunité de fréquenter une école d’art, un conservatoire ou les arts déco. La photo, comme beaucoup d’autres disciplines artistiques, me fascinait. « Le Futur du Beau » m’a tout simplement permis d’entrer dans un monde que, jusqu’alors, je regardais de l’extérieur, avec beaucoup de regrets. Je n’oublierai jamais ce jour très intense d’incrédulité et d’émotion lorsque, pour la première fois, j’ai vu mes photos en grand au musée national du Mali !
- Premier contact avec la photographie ?
OVD : Cette tradition familiale - qui n’existe peut-être plus vraiment, où encore un peu dans les milieux ruraux, plus qu’en ville - des portraits et des photos des grandes occasions, rassemblés dans de jolis albums, rangés dans un meuble, quelque part : c’est cela mon premier contact avec la photo. Mais l’image est tellement présente dans nos vies… Ici au Sénégal, il y avait le photographe de mon grand-père, Mama Casset - l’équivalent de Seydou Keïta au Mali. Il fallait passer par lui pour avoir un beau portrait. Et c’est aussi l’une de mes influences : la photo de studio très posée, comme Malick Sidibé et toute cette génération de photographes des années 40 aux années 70, dont je ne connaissais pas forcément le nom à l’époque, mais dont les clichés, enfant, étaient omniprésents dans mon quotidien.
- Vous vous considérez donc comme un autodidacte : quelles ont été, au-delà de la photographie, vos premières influences artistiques ?
OVD : J’ai passé beaucoup de temps à consommer de la photographie - et de l’image en général. Toutes ces choses que l’on voit passer étant enfant, et qui restent forcément quelque part dans l’esprit, qui influencent la façon de voir, et, plus tard, de créer : la télévision particulièrement, qui distribuait ici, au Sénégal, des programmes français (comme les émissions de Michel Drucker). On a tous vu aussi les clips de Michael Jackson dans les années 80, les pubs Kodak de Jean-Paul Goude, feuilleté des magazines africains, tels Afrique Magazine, ou français tels que Paris Match. La culture pop était omniprésente. Et tout cela créait de l’envie autant que de la frustration car je n’ai jamais été satisfait de la façon dont mon peuple et mon continent étaient montrés : un tam-tam, une girafe, un couché de soleil, des enfants qui marchent pieds nus… Ce déficit de représentation positive, ou même simplement « réelle », authentique, a contribué à me donner envie de créer. J’étais déjà l’élève qui mettait un peu plus de couleurs que tout le monde sur sa feuille de devoirs et lorsque j’étais cadre en entreprise, j’étais celui qui avait les powerpoints les plus alambiqués. Je passais plus de temps à regarder les pochettes des disques qu’à écouter réellement la musique. Je m’en rends compte après coup, cette envie de dire les choses différemment, ce goût pour l’esthétique, l’image, ont toujours été présents.
- Trouvez-vous, parmi vos contemporains, un écho à votre propre démarche ?
OVD : Oui, nous sommes nombreux à avoir ce même objectif, à vouloir montrer au monde notre réalité et nos aspirations. Tous ces gens qui ont posé dans « Le studio des Vanités » sont eux aussi en train de créer leur propre image et leur propre représentation. Que le message passe par le documentaire, la photographie de presse ou de mode, c’est uniquement la méthode qui diffère et c’est justement dans cette diversité que se trouve la réussite. Je pense que si l’on s’intéresse de plus en plus à la création africaine, c’est parce qu’elle est plurielle.
- « Le Studio des Vanités » date de 2012. Une série ouverte qui compte aujourd’hui une centaine de portraits, personnalités, amis : comment est né ce projet ?
OVD : Je considère cette série comme un carnet de bord des rencontres que j’ai pu faire au fur et à mesure que j’ai intégré cette jeune communauté créative dakaroise.
Je me suis rendu compte qu’il y avait un fil conducteur chez chacun d’eux, qui était l’envie de ré-équilibrer cette représentation de l’Afrique urbaine et de l’Afrique d’une manière générale, et une envie de prendre le contrôle de la scène culturelle. L’Afrique a connu une période faste après l’indépendance, où beaucoup des présidents et dirigeants, férus d’art, soutenaient la création - je pense notamment au président poète Léopold Sédar Senghor. Est arrivée ensuite la période difficile des années 90, avec les plans d’ajustement structurels du FMI, où l’État n’avait plus ni le temps ni les moyens de soutenir les artistes ; la culture est alors devenue le parent pauvre. Fort heureusement, grâce à la coopération avec, notamment, les anciennes puissances coloniales, les centres culturels français, le Cute Institute, des institutions ont pris le relais. Mais les artistes n’étaient pas en mesure d’engendrer seuls la dynamique. Je pense que ce qui s’est passé avec les artistes de ma génération, c’est qu’il y a eu une envie au départ, et, par les réseaux sociaux, une possibilité réelle de prendre le contrôle. Tous ces gens que je photographie, bloggers, journalistes, chorégraphes, curators et curatrices, maquilleuses, mannequins, chanteuses, etc. ont des looks très marqués, et comme moi, ils partagent cet amour pour le nouveau, le contemporain, et aussi ce besoin de faire des références à leur patrimoine visuel, avec ce goût pour le vintage. Au début, je prenais seul en charge toute la mise en scène et le stylisme. Et puis je me suis très vite rendu compte que mes modèles avaient une personnalité et une apparence tellement riches que je pouvais nourrir la série en les laissant s’exprimer. C’est à partir de là qu’il y a eu un véritable dialogue entre mes modèles, mes « clients », et moi, une collaboration, des allers-retours entre leur garde robe et la mienne, du temps passé à chiner dans les marchés de Dakar, à piocher chez les designers. J’ai eu envie de fixer toutes ces personnalités, tous ces mélanges, cette quête de renouveau.
- Une autre série « Diaspora » a vu le jour, en dix-huit portraits
OVD : J’étais en résidence de création à Malaga, en Espagne, lorsque l’idée de cette série m’est venue. Je m’intéressais beaucoup à la peinture classique, Velasquez, Matisse, etc. et je cherchais à maîtriser davantage le traitement de la lumière sur des peaux noires. C’est au cours de mes recherches que je suis tombé sur ces portraits : celui de Juan de Pareja, esclave puis assistant de Diego Velasquez, celui de Jean-Baptiste Belley par Girodet… Je me suis rendu compte que je ne connaissais pas ces personnages qui avaient quitté le pays au temps des colonies et de la traite négrière, et étaient devenus des personnalités en dehors du continent. En lisant leurs biographies, j’ai découvert des histoires incroyables. Celles de Jean-Baptiste Belley par exemple, né sur l’île de Goret, à quelques minutes de nage de mon propre lieu de naissance, révolutionnaire Sénégalais qui fut le premier député français noir à siéger à la Convention Nationale, puis au conseil des Cinq-Cents, Malik Amabar, esclave éthiopien devenu ministre et chef de guerre de la ville d’Ahmadnagar en Inde, ou encore Albert Badin, majordome de la reine Louise Ulrique de Russie et figure de la cour de Suède. Je n’en avais jamais entendu parler. Et il y en avait beaucoup d’autres. Cela a créé une fascination et une insatisfaction. J’ai trouvé injuste que, surtout dans le monde actuel, on soit finalement si peu encouragé à regarder et à voir les choses qui pourraient nous unir. Je me suis dit que ces personnages-là étaient des exemples, et que leur histoire devait être racontée. Et la série est née ainsi.
- Vous vous mettez donc vous-même en scène dans ces portraits, mais il ne s’agit pas « d’autoportraits » pour autant ?
OVD : J’aurais très bien pu chercher des modèles plus ou moins ressemblants, mais j’avais envie et besoin de donner davantage qu’un cliché. Alors je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de me mettre en scène, comme une rencontre entre ces esprits du passé et moi-même. M’investir au-delà de la photographie. J’avais envie que cette série relève plus de la performance et du pèlerinage que les autres séries de portraits pour lesquelles je prenais moins de risques en étant juste photographe.
On me demande souvent pourquoi je n’ai pas inclus de personnages féminins dans la série : là, si j’avais franchi ce pas, la « performance » en elle-même aurait risqué de prendre le dessus sur le propos.
- Et pourquoi le foot ?
OVD : L’idée était de ne pas faire des copies à l’identique. Et puis j’avais aussi envie d’intriguer avec cet anachronisme, d’inviter ces personnages historiques dans une conversation qui a lieu en ce moment sur le rôle et la place de l’homme noir, du peuple noir : qu’est-ce que l’on a apporté ? Ce n’est peut-être pas évident pour tout le monde et ce n’est donc pas inutile de faire une piqûre de rappel. J’avais envie qu’au sortir d’une exposition, ou après avoir lu un article sur cette série, les gens aient envie de « faire leurs devoirs à la maison », qu’ils aient envie d’aller voir un peu quelle était l’oeuvre originale et découvrir, comme moi je l’avais fait, quelles étaient ces incroyables destinées, Dom Nicolau, prince du Kongo et premier leader africain à s’opposer par écrit à la politique coloniale, Angelo Soliman, enlevé enfant dans l’actuel Nigeria, ramené comme esclave en Europe où il fut domestique, mathématicien, philosophe, confident de l’empereur d’Autriche Joseph II, de Mozart et de Haydn. Après sa mort en 1796, il fut empaillé comme un animal de luxe, paré de plumes et de coquillages. Sa dépouille naturalisée décora un salon impérial jusqu’en 1848, date de l’abolition de l’esclavage. Toutes ces histoires… Et pour rappel, il n’y a pas si longtemps, cet entraîneur du championnat français qui sortait les pires propos sur la qualité intellectuelle d’un joueur noir, tout en valorisant ses qualités physiques. Le football, au-delà du sport qu’il représente d’une manière générale, est aussi un très bon baromètre quand il s’agit d’évaluer où nous en sommes en termes de respect, d’acceptation, et de valorisation mutuels.
- La série « Liberty » est également une réflexion sur l’histoire du peuple noir
OVD : Une passerelle entre deux continents, Afrique et Amérique, un trait d’union entre deux parties du monde où le peuple noir s’est révolté, où les luttes pour la reconnaissance des droits peuvent être, encore aujourd’hui, très violentes. Une juxtaposition des moments marquants de l’histoire de cette protestation, qui tend à en soumettre une lecture plus universelle.
Après « Diaspora », où je montrais des destins personnels remarquables, j’ai éprouvé le besoin de présenter ces groupes d’hommes dans un contexte d’affirmation, de contestation et de revendication. Chaque fois que, dans l’histoire, le peuple noir a été confronté à d’autres peuples, il a dû lutter pour sa dignité. La privation des libertés fondamentales, l’oppression, l’exploitation, on les connait depuis nos premiers contacts avec le monde arabe - car l’esclavage n’a pas été le simple fait de l’Occident, il a débuté en Orient. Et lorsque le mouvement d’émancipation a émergé aux États-Unis, et que les noirs américains ont cherché à se rebeller, il y avait déjà eu des mouvements indépendantistes sur le continent lui-même. Il y a eu par exemple dans les années 30, au Nigéria, ce que l’on a appelé « La guerre des femmes d’Igbo » - où des milliers de femmes (de l’ethnie Igbo) se sont soulevées contre la puissance coloniale britanique de l’époque. Et aujourd’hui, il y a le mouvement Black Lives Matter, qui a eu comme élément déclencheur la mort tragique de Trayvon Martin, un jeune noir américain assassiné en Floride - qui nous rappelle, même si l’histoire n’est pas toujours la même, d’autres tragédies, par exemple celle de cette jeune prêtresse Aline Sitoé Diatta, accusée d’avoir proclamé en 1944 la résistance des agriculteurs de sa région, la Casamance, contre des bouleversements imposés par la France coloniale, arrêtée pour insurrection, et décédée à vingt-quatre ans victime de mauvais traitements. Toutes ces histoires méritent d’être racontées. Je ne suis pas le premier, et je ne suis pas le meilleur non plus, mais si je peux apporter ma pierre à l’édifice, pourquoi pas. « Liberty » pourrait être en quelque sorte le Tome II de « Diaspora », une sorte de recueillement solennel, une célébration de cette quête ineffable d’une liberté trop souvent bafouée.
- À quoi vous sert l’art ?
OVD : À emprunter de nouvelles voies, à contrebalancer des clichés trop bien ancrés, à corriger des insatisfactions - notamment la façon dont l’Afrique que je connais est représentée. On parle volontiers de l’Afrique exotique, de la savane, de la forêt. Pas de l’Afrique urbaine, l’Afrique de Dakar. On a très peu de visibilité sur ce que c’est que d’être un jeune africain créatif en 2017. Réaliser une série de portraits uniquement dédiée à de jeunes artistes africains me permet de parler d’une réalité qui n’est pas assez évoquée. Monter des projets comme « Diaspora » ou « Liverty », où je tente de lever le voile sur une partie de l’Histoire humaine dont plus personne ne parle, et qui reste inconnue des africains eux-mêmes, de mettre en lumière ces légendes passées, c’est aussi m’interroger, par l’art, sur le rôle que je peux jouer dans ma société.
- Parmi les cinq sens, quel est celui que vous utilisez le plus ?
OVD : La vue est extrêmement importante bien sûr, mais il existe aussi une sorte de sixième sens que je sollicite beaucoup, une combinaison entre la vue et l’écoute. Quand on est photographe, on est un peu voleur, on observe énormément et on ne se contente pas de ce que l’on nous donne : on essaye de lire ce qui n’est pas écrit, on essaye de voir ce qui n’est pas montré. Ce sixième sens, c’est l’écoute au sens figuré, cette capacité à absorber tout ce qui transparait d’une personne, et qui peut contribuer au final à la richesse d’un travail photographique.
- Quelle est l’activité qui vous permet de reposer vos yeux et de ressourcer votre envie de photographier ?
OVD : Écouter de la musique. Les yeux ne se reposent jamais, mais la musique est un moyen de me plonger dans un contexte différent, sortir de ma réalité. Je voyage énormément et je suis incapable dormir en avion. En revanche, je peux rester six heures avec de la musique dans les oreilles, les yeux fixés quelque part - et je suis parti.
- De nouvelles séries en préparation ?
OVD : Beaucoup. Comme ces musiciens qui enregistrent une centaine de chansons pour ne sortir que deux singles.
QUESTIONS SUBSIDIAIRES
- Quel (autre) métier auriez-vous aimé faire ?
OVD : Peintre, ou créateur de mode.
- Quel métier n'auriez-vous pas aimé faire ?
OVD : Chirurgien.
- Qu’est-ce qui vous fait réagir le plus de façon créative, spirituellement, ou émotionnellement ?
OVD : La fascination. Tous ces gens devant qui j’ai plein de questions, sans trouver de réponses. Photographier un inconnu ne m’intéresse pas du tout. Le reportage ou la photo de rue ne sont pas des disciplines qui m’attirent.
- Qu’est-ce qui, au contraire, vous met complètement à plat ?
OVD : La bêtise humaine (je ne peux plus regarder les infos).
- Quelle est votre drogue favorite ?
OVD : La cigarette.
- Quel bruit, quel son, aimez-vous ?
OVD : Le silence...
- Quel bruit détestez-vous entendre ?
OVD : Le bruit de la mastication.
- Qui aimeriez-vous shooter pour mettre sur un nouveau billet de banque ?
OVD : Meryl Streep.
- Quel est votre juron, gros mot, blasphème favori ?
OVD : « Putain » (que je remplace parfois par « punaise » - mais c’est bien putain que je veux dire).
- Quel don de la nature aimeriez-vous posséder ?
OVD : Lire dans les pensées.
- Quel est, selon vous, votre principal défaut ?
OVD : L’impatience.
- Pour quelle faute avez-vous le plus d’indulgence ?
OVD : La faute de goût.
- Quelle qualité appréciez-vous le plus chez les autres ?
OVD : La bonté.
- Avez-vous un objet fétiche, un porte-bonheur ?
OVD : Une plume de pintade (c’est un oiseau très beau, et une volaille délicieuse aussi (…), que l’on considère ici comme un animal porte-bonheur). J’aime les oiseaux, les paons, les faisans - et si je vois une jolie plume par terre, je suis sûr de la ramasser.
- En quoi aimeriez-vous être réincarné ?
OVD : En cheval sauvage.
SI VOUS ÉTIEZ
- Une couleur ?
OVD : Le bleu.
- Un objet ?
OVD : Une bonne couette.
- Un lieu ?
OVD : Dakar.
- Un parfum ?
OVD : Un parfum de la collection privée de Dior,
Leather Oud.
- Un sentiment ?
OVD : La compassion.
- Une saison ?
OVD : L’automne.
- Un personnage célèbre ?
OVD : Beyoncé.
- Un alcool ?
OVD : Un Chivas 25 ans d’âge.
- L’un des quatre éléments ?
OVD : L’eau.
- Une œuvre d’art ?
OVD :
La chapelle Sixtine.
UN PHOTOGRAPHE + UN LABO
Omar Victor Diop & Processus
- Pourquoi avez-vous choisi Processus ?
OVD : Pour la qualité des prestations et le rapport personnalisé avec l’équipe.
Interview : Sandrine Fafet
(Décembre 2017)