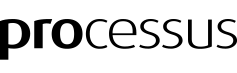INTERVIEW
- Premier contact avec la photographie ?
Édouard Élias : Je n’ai jamais conçu la photographie comme un outil pour « embellir » ; elle a toujours été pour moi le moyen de garder une trace.
J’ai grandi avec mon père (italo-égyptien) à Charm el-Cheikh, en Égypte, et avec mes grands-parents maternels, qui étaient français, et qui m’accueillaient pendant les vacances scolaires. Quand je suis revenu habiter en France, je retournais en Égypte pour les vacances. Durant toute mon enfance, j’ai été partagé entre ces deux pays. J’ai appris à considérer les images comme des objets, des souvenirs matériels de tous ces lieux dans lesquels je ne faisais que passer. Et puis j’ai perdu beaucoup de proches ; la photographie est aussi un moyen de garder un souvenir de ceux qui disparaissent.
- Double éducation, partagé entre deux continents, deux cultures, à cet âge, ce n’était pas trop déstabilisant ?
EE : La photo m’a beaucoup aidé justement. J’étais un gamin chiant, qui ne savait pas jouer au foot, un enfant très timide qui n’arrivait pas trop à parler avec les gens. Alors, dès que j’avais un appareil entre les mains, j’en profitais pour fixer des moments de vie. La photographie est devenue pour moi une façon de communiquer, qui me conférait une utilité dans le groupe tout en me permettant de rester en retrait, dans mon monde.
Et c’est le cas aujourd’hui encore. J’ai toute légitimité, en tant que photographe, à me rapprocher de l’intimité des gens, mais je dois faire oublier ma présence et travailler sans interférer. Être dans le groupe sans en être, c’est là que je suis le mieux.
Et puis, mes grands-parents étaient passionnés d’histoire ; mon grand-père militaire, résistant, et ma grand-mère, qui était « la femme de mon grand-père » m’ont tous deux transmis cette passion pour les livres et pour l’histoire. Enfant, je regardais les documentaires d’Alain Decaux (quel choc quand il est mort il y a trois ans ! Bien plus que Johnny !) C’est ainsi que, petit à petit, on se façonne. Je me souviens par exemple de cette fille afghane que j’avais vue en couverture du
National Geographic, la célèbre photo de Steve McCurry. Je la trouvais fascinante.
Mon enfance m’a permis d’acquérir la faculté de mouvement, de la découverte, ce besoin de ne pas me limiter aux frontières de mon village ou des villes de ma région. J’ai aussi appris à considérer la photo comme document historique et j’ai été très tôt sensible aux événements géopolitiques, autant qu’aux problèmes des mouvements de populations liés à la guerre, ou à la souffrance. Mon but, aujourd’hui encore, est de parler d’histoire, de raconter une histoire, quelque chose qui est en train de se passer quelque part, et de le montrer au reste du monde.
- Ce qui explique que vous vous êtes très vite dirigé vers le photojournalisme. Quel a été votre parcours ?
EE : Après le Bac, et surtout pour me conformer à des attentes familiales, j’ai intégré une école de commerce. Mais ce n’était pas du tout fait pour moi, il n’y avait aucune compatibilité possible. Très vite, je suis devenu « le photographe » de l’école - photos de promos, communication, etc. (j’étais payé mais exploité, à l’époque, je ne le savais pas !). Et je faisais des photos de mariages le week-end. Je travaillais de plus en plus et je me suis rendu compte que je gagnais ma vie avec la photo. Au bout de deux ans, j’ai arrêté l’école de commerce pour tenter une reconversion dans une école de photographie à Nancy. Je me suis retrouvé avec des jeunes qui sortaient du lycée, à qui les parents payaient tout, qui n’étaient pas très impliqués, qui préféraient s’éclater en soirées. Techniquement, je trouvais que je ne progressais pas assez vite. Alors, au lieu de faire mon stage de fin d’année dans un commerce de photos d’identité, je suis parti en Turquie sur les camps de réfugiés Syriens. Je voulais faire du reportage. C’était une révélation, j’étais au bon endroit. Différentes rencontres, par exemple le reporter Luca Catalano Gonzaga à Rome, les livres de l’agence Magnum, certains documentaires sur la photographie de reportage m’ont donné l’envie de voir l’Histoire en cours, de la vivre grâce à mon appareil photo et surtout de ne pas l’oublier.
En Turquie, par une suite de hasards incroyables, j’ai rencontré des Syriens qui m’ont emmené avec eux en Syrie. Et je suis allé faire des photos à Alep, à 21 ans, avec Stephen Dock, et d’autres journalistes que j’ai suivis là-bas. Je ne connaissais personne. Avant mon départ, j’avais écrit au
Monde et à
Libé mais bien sûr personne ne m’avait répondu ! En rentrant je suis passé à Visa pour l’Image, j’ai rencontré Jean-François Leroy et Patrick Chauvel, qui ont vu mes photos, et qui m’ont aidé à les publier. Pour mon premier reportage, j’ai fait deux doubles pages dans
Paris Match,
Der Spiegel,
Sunday Times magazine, et la sélection "Masterclass" du World Press. Je suis rentré chez Getty et ensuite j’ai travaillé pour l’AFP en Syrie en hiver 2012 jusqu’au printemps 2014 où j’ai été fait prisonnier avec Didier François.
- Six mois de détention en Syrie… Cette expérience ne vous fait pas renoncer au reportage.
EE : Non, et mes amis me disent que je suis toujours aussi « con » qu’avant ! C’est rassurant. J’évite les zones à possibilité d’enlèvement élevée, mais cela ne m’a empêché de retourner en zones de guerre, quand le sujet m’intéressait. Je suis devenu un peu claustro, et myope aussi. Mais je ne fais pas de cauchemars la nuit. Mes tout premiers reportages ont été plus douloureux ; voir des morts pour la première fois, par exemple.
- Et après la Syrie ?
EE : Je suis parti en Centrafrique avec l’armée française, la légion étrangère, Sangaris, le Tchad, le Cameroun, la Méditerranée, l’Irak et l’Ukraine. J’ai sillonné l’Afrique, le Kenya, l’Éthiopie, la Mauritanie. Je ne cherche pas à faire « mieux » que les autres photographes qui couvrent ces mêmes zones, mais j’essaye de passer du temps avec les gens sur place. Sur les puits de pétrole en Irak par exemple, j’ai passé quinze jours non stop avec les pompiers. Au Moyen-Orient j’ai travaillé pour des ONG, au Liban, en Jordanie, j’ai travaillé avec Première Urgence Internationale. Mais je travaille aussi pour
Gala. J’ai même suivi Alain Juppé pendant six mois, comme photographe officiel : je voulais faire le reportage en argentique, mais ma proposition n’a pas été acceptée parce le procédé l’aurait « vieilli ». C’était aussi une expérience intéressante.
- Le quotidien d’un photographe, ça ressemble à quoi ?
EE : Parfois, des magazines m’appellent et me disent : « Tu serais dispo pour partir au Bangladesh dans deux jours ? » ou bien : « On voudrait la photo d’un Rafale de face en train de décoller, tu peux le faire ? »… Quand je suis parti en Ukraine, j’avais pré-vendu mon sujet à
Polka, mais au retour, rien que pour rembourser mes frais, il m’a fallu vendre mon sujet à trois ou quatre médias supplémentaires. Les médias n’ont plus les moyens de supporter les jeunes photojournalistes. Dans vingt ans, il ne restera plus que des images de news. C’est pour cela que j’ai eu envie d’explorer différents formats, avec l’impression d’art par exemple, et l’héliogravure : pour me donner les moyens de travailler librement. Mais c’est très compliqué. Je n’ai pris aucunes vacances depuis cinq ans. On m’a même mis en garde, au début : « Les petits jeunes, avec vos numériques, vous ne savez pas faire de photos, vous ne savez même pas exposer ! ». Et puis dans les festivals, les photographes les plus reconnus ont le monopole, et il est difficile d’entrer dans ce milieu sans avoir de bons contacts.
Lorsque j’ai été sélectionné pour le festival de photo La Gacilly, par exemple, j’ai trouvé la proposition géniale : j’avais carte blanche ! En réalité, j’ai eu carte blanche jusqu’à ce que l’on me dise qu’on aimerait bien que je fasse des photos plutôt en couleur, qu’on aimerait bien que je travaille sur le Morbihan, et que ce qui serait vraiment bien, c’est que je travaille sur l’habitat précisément. Avec seulement deux semaines pour trouver par moi-même les contacts sur place avec les gens, gagner leur confiance, entrer chez eux, etc. Finalement, même s’il s’agissait davantage d’une commande que d’une « carte blanche », ce fut un bon exercice. J’ai toujours adoré travailler avec VSD pour cette raison. C’était un magazine qui payait bien les reportages et qui traitait vraiment bien ses photographes, à l’inverse des magazines culturels dédiés à la photo qui proposent une belle vitrine, mais qui ne te font pas vivre.
VSD, si, et c’était une équipe à l’écoute des photographes, qui ne te reprochait jamais d’avoir fait des choix.
VSD faisait partie de ces gens qui font vivre le métier de photographe. Tous les magazines ne le font pas. Maintenant on nous promet : « grâce à nous tu vas être connu ». Je rêverais qu’on nous soutienne dans nos projets ! Mais le système ne fonctionne pas de cette manière. J’investis chaque fois tout ce que j’ai dans un reportage que je dois financer seul. Je m’en sors à la fin, mais je trouve qu’il faut prendre des risques énormes.
- Transmettre, c’est important pour vous.
EE : Je donne des cours de photo au CFPJ (le centre de formation pour les journalistes) et je fais des interventions à Sciences Po sur le photojournalisme.
Avec Christine Amanpour, la présidente du jury du prix Bayeux-Calvados des Représentants de guerre, j’ai commencé à travailler avec des scolaires, en passant par l’Éducation nationale et les rectorats. Je remarque que dans ce contexte, les enfants sont plus intéressés par des photos imprimées que par des images sur écrans - parce que des écrans, ils en consomment déjà toute la journée. Quand je me rends dans une école, je peux montrer des planches contact, expliquer le procédé, parler du négatif, comparer les différents moments du déclenchement, leur raconter comment s’est passée la prise de vue. Et pas un simple écran avec « avant / après ». Il y a tellement d’images aujourd’hui qui circulent, partout, que si l’on arrive à arrêter une personne plus de quinze secondes sur une photo pour lui expliquer comment et pourquoi elle a été faite, c’est une vraie victoire.
- Les tirages d’art et l’héliogravure, c’est venu comment ?
EE : Avant, j’avais un tireur à Marseille, qui me faisait de beaux tirages 60x90, 80x260, que je faisais contre-coller, et qui voyageaient d’expo en expo. Je lui envoyais mes fichiers et il les imprimait en jet d’encre. Mais je trouvais dommage d’avoir une démarche proche de l’artisanat à la prise de vue, pour laisser des machines reprendre ensuite le dessus.
Je fais de la photo en tant que photojournaliste parce que j’aime raconter des histoires, mais j’ai toujours été fasciné par les livres, les livres d’histoire, les livres de photos, les beaux tirages - la photo en tant qu’objet. Avec le travail de presse, je m’en suis éloigné, en travaillant avec du matériel numérique très rapide, pour envoyer les photos toutes les 48 heures au journal, enchaîner les commandes, etc. Je suais sur le terrain, je donnais des émotions, je ne passais pas de temps avec ma famille - le reportage en quelque sorte, mais j’avais surtout l’impression que les images se volatilisaient. Je faisais un sujet, et puis je passais à un autre sujet, et puis encore un autre. Je travaillais pour l’actualité, et c’était très intéressant, j’avais de bons retours et c’est valorisant pour l’égo. Mais de ces histoires qui se déroulaient, il ne me restait rien d’autre que des fichiers numériques dans des petits dossiers. Avec tout ce que je donnais dans un reportage, j’avais besoin de recevoir quelque chose de plus humain en retour. Même moins parfait.
Je me suis dit qu’il fallait que je revienne à la base, c’est-à-dire la planche-contact, le néga, les tirages, les livres : des objets.
Et j’ai rencontré Fanny Boucher, qui elle est héliograveuse. Cette façon de travailler correspondait exactement à ce dont j’avais besoin.
- L’héliogravure est une démarche qui va a l’opposé des habitudes d’Instagram…
EE : Instagram est un bon support. Utiliser ces réseaux pour communiquer, échanger, et permettre de repartir en reportage, c’est génial. Mais j’ai parfois l’impression que mettre des images sur Facebook pour récolter des like est devenu une finalité. Et les images qui restent, comment les montrer ? On ne passe pas plus de quinze secondes sur une photo de son fil d’actualité. Je trouve qu’avoir des objets entre les mains, c’est important. L’héliogravure un savoir-faire ancien qui demande du « temps » : il faut une journée entière pour graver une plaque de cuivre.
- Quelles sont les étapes de ce procédé ?
EE : Fanny agrandit la photo par ordinateur pour ensuite la poser sur une gélatine photosensible, une sorte de pellicule géante, qu’elle colle sur une plaque de cuivre avec un mélange à base de chlore. La gélatine une fois collée, elle passe des acides qui vont réagir différemment suivant la manière dont la plaque a été insolée. Les acides pénètrent la gélatine pour graver le cuivre en profondeur. Tout est fait à la main dans de grands bacs et une grande partie du travail est faite à l’aveugle. À la fin, il faut tout enlever, stabiliser, et on obtient une plaque de cuivre gravée, c’est incroyable ! Fanny a quarante ans et pratique l’héliogravure depuis vingt ans. Aujourd’hui, ils sont moins de dix au monde à détenir ce savoir-faire. Elle est considérée comme maître d’art, c’est-à-dire que ce savoir-faire n’est plus enseigné.
Avec Fanny, j’ai trouvé quelqu’un avec qui travailler. Quand je choisis une photo, je sais ce dont elle a besoin pour imprimer (des photos plutôt contrastées, pas trop de ciel parce que les teintes claires sont difficiles à rendre, des clairs-obscurs, etc.) et cette collaboration est passionnante. Fanny étudie les sujets et apporte ses émotions, son geste, et sa réflexion. Tout le procédé n’est pas argentique puisque je lui envoie mon négatif scanné qu’elle imprime sur un positif transparent. Mais je ne cherche pas à être un puriste de l’argentique. Je cherche à utiliser le meilleur des deux. Ce que j’aime avec le négatif, c’est que j’ai un objet unique. Une plaque de cuivre est aussi un objet unique, qui restera dans le temps.
- Avec toujours, en toile de fond, cette notion de transmission ?
EE : On fait découvrir l’héliogravure à des classes défavorisées. On se déplace, Fanny et moi, avec une presse, taille douce, des mini matrices et on fait des mini tirages. On ne signe pas, on ne numérote pas, et donc on ne casse pas le marché de l’art. Les enfants encrent eux-même ma matrice, ils la passent dans la presse et ils récupèrent leur photo en deux exemplaires : une pour offrir à quelqu’un et une pour eux, pour raconter une histoire sur les images, que j’ai sélectionnées pour qu’elles puissent sensibiliser aussi les enfants sur le thème de la guerre.
On pourrait parler de « mécénat », en quelque sorte. On gagne par ailleurs de l’argent avec le marché de l’art, Fanny travaille avec l’artiste JR, mais lorsque l’on travaille avec les institutions, on ne gagne pas d’argent. Et c’est ce que j’explique aux gens qui me demande : « Mais ça vous fait quoi de vendre aussi chers des photos de gens qui ne possèdent rien ? » Je réponds que c’est mon métier : « Comment connaissez-vous l’existence de ces gens-là, vous ? Parce que je suis allé sur le terrain pour les photographier. Et si vous voulez que des photographes continuent à montrer ce qui se passe, pour que vous puissiez y avoir accès, il faut que l’on trouve les moyens de le faire. » C’est tout le message. Car, oui, je vais vendre 2000 € un livre avec des réfugiés qui sont en train de crever en mer, on peut voir les choses de cette manière. Mais c’est ce qui va me permettre d’en témoigner et de financer d’autres projets.
- La photographie vous a-t-elle appris quelque chose que vous n’imaginiez pas ?
EE : Quand j’ai commencé la photo, j’étais très pointilleux sur la technique. Trop pointilleux. Plus j’avance, plus j’essaye d’humaniser ma photo. Plus je suis influencé par les gens, sur le terrain, et plus j’ai envie que ma photo se nourrisse elle aussi de ces rencontres, qu’elle ne soit pas uniquement le support objectif d’une réalité que j’ai photographiée. Ma façon de travailler est beaucoup plus aléatoire qu’à mes débuts, je laisse plus de place à l’imprévu, au grain, au flou, à l’erreur humaine. Je pense que la photo numérique est trop parfaite, je ne veux plus être dans cette course. Je veux photographier des gens avec leurs perfections et leurs imperfections. Je reste très attaché aux cadrages et aux compositions. Mais avant, je recherchais l’image nette, le piqué au point près, et si le point n’avait pas été fait sur l’oeil mais sur le nez, même avec un 35 mm, j’écartais la photo. Heureusement, j’ai tout archivé ! Je redécouvre des photos en me me demandant pourquoi je ne les avais pas choisies à l’époque. De l’imparfait, sans être complètement dans du hasard, un peu penché, éventuellement, des parties bouchées, des parties grillées - c’est encore difficile de laisser du gris, mais j’essaye de relâcher.
- Quelques souvenirs plus marquants que d’autres ?
EE : Les légionnaires, en République Centrafricaine, avec qui j’ai travaillé sur une période d’un an. J’ai passé un Noël avec eux et dormi au régiment ; les gars m’ont même offert un cadeau ! Les légionnaires n’aiment pas beaucoup les journalistes en général, mais beaucoup sont devenus des amis. Plus tard, les images ont été achetées par le musée de l’armée aux Invalides. Et je me suis dit que ces portraits allaient me survivre. Les légionnaires eux-mêmes m’ont remercié, fiers de se retrouver aux Invalides. Quand j’ai fait l’exposition au Pont du Gard, ils venaient avec leur famille. Ils me disaient qu’on allait enfin voir ce qu’ils avaient vécu. C’est une vraie reconnaissance.
Le reportage sur les puits de pétrole en Irak, où j’ai partagé la vie de ces pompiers, est également un grand souvenir.
Et puis, un sujet pour
VSD, aussi, dans un centre éducatif. Le journal m’appelle pour me proposer un sujet compliqué, avec la police judiciaire de la jeunesse. Il s’agit de mineurs, en prison, dont on n’a pas le droit de montrer le visage. Trois pages grand maximum, et peut-être même simplement une illustration pour un texte. J’accepte la commande, en proposant le N&B. J’ai réussi à cacher le visage des détenus mineurs, grâce au contraste, soit en cadrant de façon très large, soit en jouant sur la lumière. Finalement, on a fait huit pages !
Mais le souvenir le plus dur, c’est la Syrie : ce médecin qui vient me chercher pour me dire de faire mon travail, que je n’étais plus capable de faire… Dans un conflit comme celui-là, tu sais que ces gens sont morts en attendant que tu les aides. J’étais à l’hôpital, à Alep, et les victimes d’un bombardement venaient d’arriver. À ce moment-là, je suis parti chialer dehors tellement je n’en pouvais plus. L’un des médecins est venu me rechercher, me dire qu’on avait besoin des photographes pour montrer ce qu’il se passait, et ce qu’on était en train de leur faire, à eux aussi… Alors j’y suis retourné. J’ai fait mon travail.
Après, rien n’a changé. Absolument rien. Ce travail ne sert peut-être à rien, mais au moins j’essaye. Je suis allé voir ces gens, j’ai vécu ces choses-là, Je me suis imprégné. J’ai été touché. Et je témoigne. Je peux expliquer que le Syrien qui est ici ne vient pas pour te piquer ton travail, mais qu’il est en train de fuir la guerre, et peut-être que cette personne qui m’écoute sera plus respectueuse. Peut-être qu’il y aura un éveil des consciences, dans un siècle, dans deux siècles et qu’au moins on laisse des documents sur ce qui s’est passé.
QUESTIONS SUBSIDIAIRES
- Quel (autre) métier auriez-vous aimé faire ?
EE : La moto, la mécanique. À 16 ans, on me disait que la moto en circuit, c’était trop dangereux. J’ai choisi la photo. Mais j’aurais voulu faire le métier de mon père, qui était champion de moto en Italie dans les années 70.
- Quel métier n'auriez-vous pas aimé faire ?
EE : Travailler dans le commerce, le business, le marketing, le management, tous ces métiers où je n’aurais pas eu l’impression d’être ancré dans la réalité.
- Quelle est votre drogue favorite ?
EE : La musique classique à 4h du matin en pleine phase de mélancolie.
- Qu’est-ce qui vous fait réagir le plus de façon créative, spirituellement, ou émotionnellement ?
EE : J’ai un gros problème à différencier le positif et le négatif : je suis quelqu’un de mélancolique. Je ne fais pas trop d’images joyeuses. (J’essaye, parfois, pour
Gala…) Je n’ai pas de montées de joie intenses, et là où je me sens le plus à l’aise, c’est quand je fais des photo, que j’entre dans l’intimité des gens, que je me fais oublier par mon sujet, et que je suis dans mon monde.
- Qu’est-ce qui, au contraire, vous met complètement à plat ?
EE : La routine, la normalité. C’est là que je commence à trop réfléchir…!
- Quel son aimez-vous ?
EE : Le vent. On dit que le vent rend fou ! Moi, j’ai grandi en Egypte sur un bateau en mer Rouge… et j’adore sentir le vent en pleine mer, ce silence assourdissant.
- Quel bruit, quel son, au contraire, détestez-vous entendre ?
EE : Les bruits de foule (en réaction avec ma détention). Quand je suis fatigué, au milieu du brouhaha, j’ai l’impression d’entendre des cris.
- Quel est votre juron, gros mot, blasphème favori ?
EE : Il y en a un que j’adore, c’est « kurwa », parce que c’est celui de la légion étrangère. C’est une injure polonaise qui veut dire « putain ». On finit par croire que c’est du français, tellement tout le monde l’emploie. Ce n’est pas forcement le juron que j’utilise le plus mais c’est celui que je préfère, parce qu’il est très lié à la légion, à la Russie, etc. C’est vraiment une insulte de l’Est.
Et sinon, il y a « merde, merde, merde, merde ! » Ça, c’est quand je suis dans une situation un peu compliquée.
- Quel don de la nature aimeriez-vous posséder ?
EE : L’invisibilité ! (le classique du photographe ! ) … invisibilité pour moi et pour mes équipements aussi bien sûr, parce que ce serait bizarre de voir un Leica flotter au milieu de rien.
- En quoi aimeriez-vous être réincarné ?
EE : En cachalot. C’est le mammifère qui descend le plus profond et qui peut rester le plus longtemps dans l’eau sans respirer. (Et
Moby Dick est l’un de mes livres préférés).
- À quoi vous sert l’art ?
EE : C’est un exutoire pour sortir de la mélancolie. Et l’art est pour moi, comme le journalisme, le moyen de faire passer un message, soit par l’émotion, soit par l’information, mais les deux sont liés. Et l’art c’est apprendre, la transmission de l’émotion et de l’expérience, et l’apprentissage.
- À quoi sert un photographe ?
EE : À capter, à enregistrer les images d’une réalité, à exprimer un point de vue. Dans ma perspective propre, c’est aussi vocation historique ; pas tant devoir changer les choses, que laisser une image qui doit rester dans le temps comme document. Documenter davantage qu’informer d’une réalité, d’une situation, ou d’une émotion.
SI VOUS ÉTIEZ
- Une époque ?
EE : Le XIXème siècle.
- Un artiste ?
EE : Théodore Géricault.
- Une œuvre d’art ?
EE :
L’adoration des mages, de Léonard de Vinci.
- Une chanson ?
EE : « Time », de Pink Floyd.
- Un objet ?
EE : Un sablier.
- Une saison ?
EE : L’automne.
- Un sentiment ?
EE : La mélancolie.
- Un lieu ?
EE : La mer.
- Un parfum ?
EE : L’odeur d’iode, du sel, de la mer, mais surtout celle du mazout dans les ports.
- Un animal ?
EE : Le cachalot, bien sûr !
- Une couleur ?
EE : Bleu très clair.
UN PHOTOGRAPHE + UN LABO
Édouard Élias & Processus
- Pourquoi avez-vous choisi Processus ?
EE : J’ai été conseillé par un ami et j’ai très vite pris l’habitude de travailler avec vous ; j’apprécie la façon dont vous gérez mes négatifs. J’aime ce rituel, me rendre à Processus, déposer mes négatifs, les récupérer, découvrir mes planches contact (sans oublier les bonbons à l’accueil). J’ai besoin de savoir que je travaille avec des gens, que je fais travailler un laborantin, que je ne travaille pas seul, mais avec toute une équipe, tout un labo, que je contribue modestement à faire vivre un milieu, un métier, une réflexion. Je pose beaucoup de questions à Tom, et c’est un véritable échange. Tu crées des connexions avec d’autres gens. Il y a quelque temps, j’avais pensé m’acheter un Phase One, moyen format numérique, 100 mégas pixel etc. Mais finalement, en optant pour ce genre de matériel, j’aurais continué à fabriquer du néant, et mon dos, dans cinq ans, aurait été dépassé. Pas les films que j’apporte au labo.
L'ARRÊT SUR IMAGE d'Édouard Élias
Libye, mars 2016, les réfugiés en Méditerranée.
EE : Deuxième « rotation » du bateau : l’Aquarius part en mer chercher des réfugiés, puis revient toutes les trois semaines pour l’approvisionnement en vivres, en carburant, etc. Le laps de temps est une « rotation ».
Je n’avais pas souhaité travailler sur les réfugiés au départ, parce qu’il y avait énormément de photographes sur ce sujet, que de remarquables reportages avaient été réalisés, et que des millions et des millions d’images circulaient déjà… Lorsque l’on m’a proposé de partir, pour accompagner un journaliste avec lequel je collabore souvent, j’ai accepté, parce qu’il s’agissait de partir en mer. Je savais que la mer n’est pas seulement, pour un réfugié, l’endroit d’où l’on vient : la mer est surtout l’un des endroits les plus traumatisants qui puissent exister, avec ce sentiment de claustrophobie qui vous prend au beau milieu d’un élément naturel aussi immense.
Sur les trois semaines de traversée, l’Aquarius n’a fait qu’un seul sauvetage. C’est durant la deuxième semaine qu’un matin j’ai assisté au branle-bas de combat. Un bateau avait été repéré. En plein silence, le silence total et surnaturel de la mer au levé du jour, on a vu apparaitre l’un de ces bateaux blancs, et on a commencé à entendre les cris. Tous ces gens tétanisés, qui ne bougent pas mais qui crient, massés sur une coquille de noix, c’est horrible. Ils sont près de deux cents entassés là. Et le sauvetage commence, l’agitation, le brouhaha. Les premiers réfugiés arrivent sur le bateau, et toi ? Qu’est-ce que tu fais ? Tu aides ? Tu n’aides pas ? Il faut trouver sa place - en tant que photographe. Est-ce que je suis un observateur ? Est-ce que je participe ? Ces gens qui embarquent sont complètement perdus, et je les photographie. D’habitude, à moins que ce ne soit une simple manifestation à Paris, je passe du temps au contact des gens.
Ici, sur cette image, c’est la fin du voyage. Ils vont débarquer en Italie : certains hurlent de joie, d’autres chantent. Mais pas tous. On ressentait au contraire, chez la plupart d’entres eux, une certaine mélancolie et j’avais l’impression de les comprendre. Ces gens quittaient la Libye ; l’Aquarius était une sorte d’ambulance qui les amenait en Europe et bien sûr c’était une libération, un espoir. Mais sur cette image, on voit ce réfugié, qui, lui, reste très calme - parce qu’il sait que ce n’est pas terminé. Et d’une certaine manière, cela m’a ramené à ma propre sortie de détention.
La prise d’otage dont j’ai été victime a été pour moi un bouleversement. Même si ce que j’ai traversé n’est rien comparé à ce qu’ils sont en train de vivre, je sais ce que c’est que de sortir de l’enfer et toutes ces émotions que j’avais ressenties lors de ma libération sont remontées, et notamment à travers lui. Je comprenais leur réaction, le repli sur soi. En reportage, j’évite les regards directs. Mais sur ce reportage, je les ai cherchés ces regards, parce qu’il était important pour moi qu’ils me donnent l’autorisation de les photographier. C’est pourquoi j’ai choisi cette photo : pour la première fois, je ne me fais pas complètement oublier, j’ai besoin qu’ils sachent que je suis là, pour dire oui, montre-nous. Et malgré la frustration de ne pas pouvoir passer davantage de temps avec eux, un échange a eu lieu à cet instant. La plupart était comme lui, ils ne sautaient pas de joie, parce qu’ils savaient à quel point il allait leur falloir du temps pour se reconstruire.
Interview : Sandrine Fafet
(Janvier 2019)