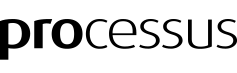INTERVIEW
- Premiers contacts avec la photographie ?
Ambroise Tezenas : Dans l’album photo familial, il y avait une photo de moi, à sept ans, avec pour légende : « Ambroise : quel métier, photographe ? » - parce que je faisais une photo de ma famille en pique-nique sur le bord de l'autoroute - photo basique, et bancale, en plus. J’ai toujours vu cette photo étant enfant, et chaque fois que l’on feuilletait l’album, cette photo me surprenait. Bien sûr, ce n’est pas cette image qui a été le déclic, mais c'est amusant après coup de se dire que finalement, je suis devenu photographe.
- Quel a été alors le véritable déclic ?
AT : Vers treize ans, en faisant des photos avec des copains, comme un jeu, un moyen de se balader dans Paris, d’être ensemble. À quinze ans, vraiment passionné, j’ai un Pentax P30 et je rêve d'avoir un vrai appareil, un Nikon. L’année suivante, un copain me dit qu’il aimerait devenir photographe ; je ne pensais pas alors que l'on pouvait en faire un métier : mon père est économiste, ma mère est journaliste. Je ne viens pas d’une famille d’artistes. Mais le fait que lui se soit posé la question et qu'il me l'ai posée, d'une certaine manière, m’a influencé. Je me suis rendu compte que c'était possible, et finalement je n'ai jamais imaginé faire autre chose.
- C’est ce que l’on appelle une vocation ?
AT : Depuis, je ne me suis plus jamais reposé la question de savoir si je pouvais, où si je voulais faire autre chose. Il n'y a que la photographie qui m'intéresse. Il n'y a pas que cela qui me rende heureux, mais il n’y a que cela qui me frustre autant !
Dans mon atelier, j’ai conservé mes premiers classeurs de négatifs 24x36 et 6x7, que j’ai réalisés entre quinze et vingt-trois ans. Toutes ces photos que tu ne fais plus après : des portraits, ta copine, tes parents, ces balades, ces heures entières passées à développer dans le noir… Mais je crois vraiment au « parcours » du photographe, et ces classeurs sont le témoignage de ce lent procédé qu’est la photographie. Pour réaliser ce travail sur le
Tourisme de la désolation, par exemple, il m’aura fallu cinq ans. C’est long. Au cours des années, j’ai déménagé souvent, et j’aurais pu me défaire de ces classeurs (je ne les ouvre jamais et ils prennent tellement de place) et pourtant ils sont toujours là, accessibles. Je pense que cela me rassure.
- Vous faites partie de cette génération de photographes pour qui Magnum était une référence ?
AT : À quinze ans, ce qui me fascinait - rien d’original - c'était les mythiques reporters avec leur Leica sous le bras. C'était l'agence Magnum et tous ces noms illustres de la photo.
Je voulais être reporter, je me sentais reporter - la photo de Capa accrochée au-dessus du bureau. Cela s’explique sans doute aussi parce que je fais partie de cette dernière génération de photographes qui pouvait encore espérer gagner de l'argent avec la presse, proposer des sujets et les vendre. J’ai pu le faire à mes débuts mais c’est très vite devenu une nostalgie.
En sortant de l’école, j’ai eu la chance d’être pris comme assistant pour le corporate chez Magnum : je touchais enfin le mythe qui m’avait fait fantasmer toute ma jeunesse ! Je travaillais beaucoup avec Patrick Zachmann, je lui faisais ses tirages de lecture. J’allais le soir, tout seul après la fermeture, dans le labo N&B de Magnum, et c’était absolument génial ! J’avais même accès aux archives. Ce sont des souvenirs très forts.
- Les reporters font donc également du corporate ?
AT : Avec Zachmann, j’ai photographié des caissières en patins à roulettes. Et tu réalises alors que l’auteur de
So Long China se retrouve en banlieue à photographier une caissière, oui. Plus tard, quand j’étais en agence chez Editing, on me disait que faire du corporate c’était vendre son âme au diable - mais c’était il y a vingt ans - maintenant tout le monde le fait. J’ai vite compris mon intérêt, et je n’ai aucun problème d’égo avec cette idée : je peux faire un trombinoscope d’avocats, le degré zéro de la photo, pour des gens qui te parlent mal ou faire une campagne publicitaire pour le whisky William Peel. Je ne suis pas un photographe de dossiers, de bourses, etc. et j’ai toujours financé moi-même mes projets - des projets absurdes, qui coûtent trop d’argent. Alors il faut bien trouver quelque part de quoi les financer.
- Et ensuite, les débuts d’un jeune photographe dans les années 90, c’était comment ?
AT : En sortant de l’école d’arts appliqués de Vevey, je suis venu m’installer à Paris et j’ai commencé le long parcours du combattant d’un photographe qui n’a rien, aucun réseau, un peu embué par l’école, qui se retrouve avec un grand book 40x50, de beaux tirages N&B, et qui, timidement va montrer sa vie dans les rédactions et se fait refouler parce que, des jeunes comme toi, il en défile quinze par jour. Tu as pourtant eu du mal à obtenir ce rendez-vous, mais sur le trajet retour, tu te sens nul, parce que c’est toute ta vie que tu mets dans ces photos que l’on vient de rejeter. Et ce parcours du combattant est douloureux, mais normal. Tu travailles ensuite sur des sujets sensibles (j’avais travaillé par exemple durant cinq mois sur la rééducation des accidentés de la route de l’hôpital de Garches). Tu prends le temps d’observer, tu vis ton sujet (et je ne regrette rien de cette période), tu as l’impression de t’engager, réellement, mais ensuite, les rédactions ne sont pas vraiment enthousiastes. Déjà à l’époque, on sentait un désintérêt pour ce type de sujets ni très glamour, ni très vendeur. Tandis que toi, tu te sens naïvement responsable d’un message à faire passer, avec toute l’immaturité du novice.
J’ai commencé par des commandes peu glorieuses puisque que, le monde est ainsi, on ne prête qu’aux riches. Une petite photo, et puis une deuxième, et finalement un quart de page dans
L’Express, et tu as l’impression d’avoir gagné au loto. J’ai aussi beaucoup voyagé à cette époque, j’étais parti six mois en Asie, sac à dos, avec comme excuse de chercher à faire avancer mon travail alors qu’en réalité tu te balades, tu découvres un peu le monde.
- Après les années d’apprentissage, la reconnaissance. Vous obtenez le prix Leica European Publishers Award for Photography, pour votre travail sur Pékin, Théâtre du Peuple, présenté à Arles en 2006.
AT : J’ai vite compris que j’avais un vrai potentiel pour les travaux commerciaux, mais j’avais aussi fondamentalement besoin de retrouver du temps pour travailler pour moi, à mon rythme, à ma façon. Pékin venait d’être choisi pour les JO de 2008 et pendant cinq ans, je suis retourné là-bas tous les ans à la même période. J’ai présenté ce travail réalisé entièrement à la chambre au Leica European Publishers Award for Photography et j’ai été primé. Je n’appartenais pas vraiment au monde de la culture, des éditeurs, des galeries, et subitement, je me suis retrouvé à Arles avec Raymond Depardon me remettant le prix, Leica m’offrant un boitier et sept éditeurs européens qui proposaient d’éditer mon livre traduit en sept langues, avec des expositions en Europe et en Asie ! Dans le jury, il y avait François Hébel, le directeur d’Arles, ancien patron de Magnum mais qui, à l’époque où j’étais stagiaire, ne me remarquait pas (et c’est bien normal). Sans que ce soit un moteur premier (je ne travaille pas pour plaire aux autres) un photographe a besoin de cette reconnaissance-là, à un moment donné. Sam Stourdzé qui me propose d’exposer aux Rencontres d’Arles, Kathy Ryan qui me propose de collaborer au
New York Times Magazine, la vente de mes images à la BNF, etc. ce sont des acteurs qui font avancer la photographie et ce sont des moments marquants. Mais je me suis assez vite rendu compte aussi qu’en photographie, on n’est jamais arrivé. Comme quand tu obtiens ton quart de page dans
L’Express à vingt ans : tu veux ta demi page et ensuite la pleine. Et ce n’est pas parce que tu as fait le quart, que l’on va t’appeler pour faire la demie. Et puis par-dessus tout, et je n’ai pas eu besoin de ce prix pour le savoir, je crois davantage au travail qu’au talent.
- Est-ce toutefois devenu plus facile de s’exprimer, après cette reconnaissance internationale ?
AT : Pas vraiment. Après l’euphorie, je me suis bien rendu compte que la photographie était un rouleau compresseur. Et j’ai voulu très vite repartir sur un autre projet. C’est un peu une obsession de photographe, trouver un sujet qui fonctionne, éviter l’écueil de l’alibi documentaire, en faire un travail photographique fort avec thématique forte, avoir besoin d’une véritable implication personnelle, etc. J’en étais là dans mes réflexions et de mes doutes lorsque Benoît Rivero, l’éditeur d’Acte Sud, me dit : « Ambroise, tu as fait un livre, c’est très bien, tu n’as peut-être rien d’autre à dire ». J’étais plongé dans mon petit dossier « idées », je cherchais désespérément un sujet et cette phrase m’a complètement déprimé ! Et pourtant… Plus tard, lorsque j’ai travaillé sur le tourisme macabre, Lise Sarfati m’a dit un jour : « Faire un livre pour faire un livre, cela ne sert à rien. Il y en a déjà tellement ! Non, il faut se dire que ce livre-là n’existe pas, mais que toi, tu aimerais l’imaginer. » Et ses paroles m’ont vraiment accompagné durant tout mon travail sur le livre
Tourisme de la désolation.
- Pour Tourisme de la désolation, vous avez donc pioché dans votre dossier « idées » ?
AT : J’ai eu un déclic lorsqu’en 2008, je tombe sur un article qui parle du tsunami au Sri Lanka. Et précisément d’un endroit là-bas où le train reliant la capitale au sud de l’île avait été balayé par la vague, et était resté éparpillé quelques années durant dans la jungle. On venait de le retirer. Jusque là, c’était devenu un lieu où les touristes, visiteurs, pèlerins passaient et s’y faisaient photographier. Il se trouve qu’en 2004 j’étais là-bas, au Sri Lanka, en vacances, au moment du tsunami. Je me suis retrouvé au milieu de ce drame. Quelques heures avant la catastrophe, je descendais la côte, j’étais un touriste. Plus tard - parce ce que je suis photographe, j’ai fait des photos du train, des corps étendus par terre, les foulards sur les visages, etc. Je tombe donc sur cet article quatre ans plus tard : monstrueux télescopage entre le selfie du touriste en short dans la jungle et ce drame que j’avais vécu personnellement, et qui restait encore traumatisant (une panne de voiture la veille de la tragédie m’a forcé à rester dans un village au cœur de l’île alors que je prévoyais de descendre sur la côte ). J’ai eu envie de lire d’autres articles, et je suis tombé sur cette notion de « Dark tourisme », sur les écrits d’un professeur anglais (que j’ai rencontré par la suite), dont le sujet d’étude était ce type d’intérêt morbide pour les lieux de drame, de guerre. Et j’ai ainsi commencé à entrer dans une histoire qui m’intéressait, sachant où je commençais, sans vraiment savoir où j’allais. Je ne suis pas vraiment un photographe de concept, mais il y a cependant une véritable responsabilité pour le photographe, dans la façon de traiter les sujets.
- Vous travaillez principalement à la chambre 4x5.
AT : J’ai toujours aimé marcher, appréhender les choses lentement. Porter du matériel ne me dérange pas. La chambre permet de prendre le temps de s’installer dans une approche plus personnelle, plus intellectuelle. À une époque où le digital commençait à arriver en force, j’avais besoin de temps, j’avais besoin de lenteur, jusqu’à parfois, avoir ce sentiment très frustrant qu’il ne se passe rien. Mais au final, accumuler les expositions, avoir de l’actu, c’est de la poudre aux yeux.
Étudiant, quand je suis rentré la première fois dans les studios de l’école photo de Vevey, je n’imaginais pas que ce vieux matériel pouvait s’acheter neuf.
Mais ma relation avec la chambre est surtout liée à un épisode très précis de mon histoire personnelle. J’ai perdu mon père durant l’année de stage. J’étais très mal, je voulais rentrer chez moi, retrouver les miens. Je suis allé annoncer mon départ au responsable du département de la photographie. Et il a alors eu l’intelligence de me proposer autre chose. Partir, mais avec du matériel de l’école, et le rapporter un mois plus tard… Ce fut pour moi un immense sentiment de libération ! J’ai emprunté une chambre, des polas N&B avec négatifs, et je suis parti dans ma petite Renault 5. Je suis allé jusqu’à Saint-Valery-en-Caux, là où mon père est enterré, en plein hiver, et j’ai longé la côte vers le sud, jusqu’à Bordeaux. J’ai découvert le pouvoir cathartique de la photographie : je roulais sans but, il pleuvait, il faisait froid. Pas l’errance heureuse de Depardon, plutôt une sorte de rage, très dense et très sombre. Photos le jour, les nuits dans des hôtels minables, je développais dans du sulfite de sodium mes photos que j’accrochais dans ma douche, et je repartais. Et ce voyage m’a fait un bien fou. Je suis revenu trois semaines plus tard à Vevey, j’ai montré mes photos à mon responsable qui les a trouvé bonnes. Je me sentais mieux. Je suis resté.
Avant cela, lors de cette année de stage que j’ai pu faire en tant que photographe pour l’armée (dans le cadre de mon service militaire) je voulais me rendre au Liban, durant les deux mois qu’il me restait à faire, réaliser mon premier reportage. J’avais prévu d’aller travailler sur le retour des chrétiens dans le Chouf et les familles du Hezbollah qui revenaient dans le centre de Beyrouth. Tout était organisé. Mais plus ce voyage approchait, plus mon père, qui était gravement malade, déclinait. Est arrivé le moment du départ et j’ai dû faire un choix : soit partir, au risque de ne pas être présent au moment de sa mort, soit rester, et renoncer à mon projet. Mon père a choisi pour moi, et m’a dit de partir. J’ai dû revenir au bout d’un mois pour enterrer mon père, et je suis reparti. C’est forcément un moment fondateur dans mon rapport à la photographie, une sorte de pacte.
Ensuite, dans ma carrière de photographe, j’ai expérimenté pas mal d’aspects de la photographie, portrait, reportage en 6x7, paysage, pub, N&b, mise en scène, éclairage - je n’ai jamais fait de mode, c’est tout. Et à un moment, j’ai eu besoin de revenir à cette relation forte entre la photographie et moi, en y rajoutant une dimension qui, avec les années, devenait de plus en plus fondamentale, être dans le fond aussi, pas seulement dans la forme, et c’est ainsi que j’ai commencé mon travail sur Pékin, à la chambre.
- Vous aviez, avant cela, travaillé pour la presse.
AT : Je me souviens d’une commande pour
Libération. Le journal m’appelle un jour pour couvrir une manifestation CGT. Je n’avais aucune envie de faire ce reportage à l’autre bout de Paris, sous la pluie, mais on ne refuse pas un travail pour
Libé. Je commence donc à faire des photos, de très mauvaise humeur, quand soudain on me crie : « Pas de photo ! » J’explique que je fais des photos pour la presse, pour
Libé, qu’on ne peut pas m’interdire de travailler ! L’homme en face de moi menace de m’attaquer si je continue. Je comprenais son combat et j’essayais de garder de la distance. Mais ce genre de rapport humain agressif ne me correspondait vraiment pas et je sentais que je me faisais violence. Cet épisode a été l’un des déclencheurs pour passer à autre chose.
- Quelques autres souvenirs de photo parmi d’autres ?
AT : J’ai un souvenir assez fort de ma première commande pour le
New York Times Magazine. Quand tu reçois un mail de Kathy Ryan, Directrice de la Photographie, qui te demande d’aller au Panama, en te disant que tu peux travailler comme tu veux à la chambre 4x5, tu te dis qu’il s’en est passé du chemin depuis ta première parution dans
Courrier Cadre… !
À cette période, au Panama, il était compliqué de faire des photos sur le pétrole et je devais me cacher (c’était au moment de la nationalisation du pétrole au Venezuela). J’avais bien conscience que le
New York Times Magazine n’aurait pas pu envoyer un photographe américain à cause des tensions entre les deux États, et le choix d’un Français n’était donc pas innocent. Je faisais des photos en 4x5 avec une Sinar, dans des champs de pétrole infestés de moustiques, sur des bateaux qui tanguaient, je mettais mes châssis tant bien que mal, c’était vraiment n’importe quoi ! Mais j’ai réussi à faire le reportage. Mon premier à la chambre 4x5. Et j’ai continué à travailler pour le
New York Times Magazine par la suite, et j’ai beaucoup voyagé pour eux.
Une autre fois, à New York, après une première prise de contact avec le
New Yorker - magazine avec lequel je rêvais de travailler, ils m’appellent pour un reportage en Tasmanie, trois jours plus tard. Je devais entre-temps aller à Washington et rentrer à Paris pour chercher mon matériel. Seulement voilà, quand le
New Yorker te propose un reportage, impossible de refuser, bien sûr ! Et je l’ai fait. Je suis d’abord allé à Washington, et je suis repassé à Paris, quelques heures, avant de repartir pour la Tasmanie, en passant par Hong Kong. Je me rappelle avoir passé quatre jours de shoot, sans plus la moindre notion du temps. J’étais en décalage complet, c’était vraiment très bizarre, et à la fois très fort.
Je me souviens aussi à Pékin, avoir couru avec ma chambre sur le dos, pour fuir des policiers, la nuit, qui me poursuivaient parce que j’étais passé au-dessus d’une clôture… Au final, toutes ces histoires ne sont peut-être pas très intéressantes, elles appartiennent au photographe. Et l’histoire ne fait pas la bonne photo.
- Numérique vs argentique ?
AT : Pour moi, une photo, c’est un tirage. Alors photographier en numérique ou en argentique, peu importe.
En revanche, le problème du numérique, pour moi, c’est de transporter 20 000 euros de matériel sur le dos. Avec le 4x5, tu peux te retrouver de jour comme de nuit sous la pluie, partout. Une chambre, si elle tombe par terre, tu la répares avec du scotch. C’est agréable. J’ai aussi quelques méfiances à shooter en numérique parce qu’alors la référence est un RAW, et ce RAW contient tellement d’informations qu’il peut te faire partir dans toutes les directions. Je préfère travailler à la chambre. Mais le monde évolue et je me suis adapté.
- Comment se passe la post-prod ?
AT : Trouver des gens de confiance n’est pas évident, et pourtant c’est fondamental pour un photographe. En retouche, j’aime que la photo soit le reflet d’une certaine réalité, de ce que j’ai vu, et du souvenir que j’en garde. Certains travaux sont tout simplement massacrés en post-prod. J’ai déjà eu plusieurs expériences assez désespérantes par le passé. Pourtant, la post-prod est ce qui fait la cohérence d’un photographe. Est-ce parce que je vieillis, j’ai maintenant davantage envie de revendiquer cet aspect artisanal du travail. La référence reste pour moi la planche contact. Je me méfie de tous ces curseurs « photoshopiens » qui te permettent de tout modifier, sans limites. Je tiens à ce qu’il y ait toujours des valeurs dans les basses et dans les hautes lumières, c’est presqu’une obsession, et je fais donc scanner mes négatifs très « mous ». Je cherche à rester autant que possible fidèle à la prise de vue et dans mes échanges avec le tireur, je garde ce côté artisanal. Je n’aime pas tricher.
- La photo vous a-telle appris quelque chose que vous n’imaginiez pas ?
AT : Que la photo peut être à la fois source d’immenses satisfactions… et d’immenses frustrations. Un peu comme la vie, sans doute. Mais j’accepte le fait que faire une photo soit une souffrance. L’idée que faire une bonne photo soit une joie infinie, je n’y crois pas, pas plus que je ne crois pas aux hasards heureux.
Et le pouvoir cathartique de la photographie, aussi. À la mort de mon père, la façon de recracher toute cette tristesse, toute cette colère, a été intimement liée à la photographie.
Et aujourd’hui encore, la façon d’appréhender mon travail, mes photos, dans la tension. Je ne crois pas à la flânerie passive, nez au vent. J’ai aussi besoin de partir loin, ressentir que je n’ai pas forcement envie de partir, d’être un peu chahuté intérieurement, et puis finalement, se retrouver très loin et ressentir un grand bien-être, se sentir en harmonie avec le paysage, penser à sa famille. S’arrêter un peu.
QUESTIONS SUBSIDIAIRES
- Quel (autre) métier auriez-vous aimé faire ?
AT : Un métier utile - plus utile que photographe : sauver des vies ? J’adore mon métier et je ne voudrais pas en faire un autre mais ce côté « artiste qui réveille les consciences »… Dans le processus de création, j’ai besoin d’être en tension, et je suis à bloc, mais après… ce n’est qu’une photo, au final.
- Quel métier n'auriez-vous pas aimé faire ?
AT : Proctologue.
- Quelle est votre drogue favorite ?
AT : Je suis assez binaire : mes enfants.
- Qu’est-ce qui vous fait réagir le plus de façon créative, spirituellement, ou émotionnellement ?
AT : L’actualité et les injustices. On se sent tellement impuissant et plein de révolte.
- Qu’est-ce qui, au contraire, vous met complètement à plat ?
AT : Les destins brisés trop tôt. Je suis plutôt optimiste, mais un optimiste réaliste, et le rapport à la mort m’obsède.
- Quel bruit détestez-vous entendre ?
AT : Les gens qui parlent la bouche pleine me rendent fou.
- Quel don de la nature aimeriez-vous posséder ?
AT : La téléportation : me retrouver sur cette petite île au sud de la Patagonie où j’ai rendez-vous demain, et plutôt que de prendre l’avion et devoir faire un Paris - Santiago, une heure et demi de trajet en voiture, une heure et demi de bateau, prendre une pilule pour ne pas vomir, etc. juste claquer des doigts et y être !
- Avez-vous un objet fétiche, un porte-bonheur ?
AT : Une photo de mon père.
- En quoi aimeriez-vous être réincarné ?
AT : Un miroir dans une maison de famille pour voir ce que mes enfants vont devenir.
- À quoi vous sert l’art ?
AT : C’est une façon de se connecter au monde.
- À quoi sert un photographe ?
AT : À essayer de rendre le réel intelligible, dans ce chaos incroyable qu’est le monde.
Mon travail sur ces dérives du tourisme de la mémoire par exemple, a donné l’opportunité à certaines personnes de s’interroger : « Est-ce que moi j’emmènerais mes enfants à Auschwitz, ou pas ? », « Est-ce que cette fascination pour le macabre n’est pas une façon de se rassurer soi-même ? », on n’est pas dans « Le macabre, par Ambroise Tezenas ». Les gens débattent ensemble au-delà des images elles-mêmes. Et pour le photographe non plus, ce n’est pas uniquement une approche picturale ou photographique, c’est aussi un cheminement intellectuel, intérieur.
SI VOUS ÉTIEZ
- Une couleur ?
AT : Le bleu. Tu es dans l’avion, tu pars de Paris avec un temps affreux, et soudain tu passes au-dessus des nuages et là, tu vois un ciel bleu, mais d’un bleu incroyable. Ce bleu-là (parce que prendre l’avion, sinon, c’est insupportable, aucun client ne te finance jamais la classe business, et tu te retrouves pendant tout le voyage avec les genoux au menton coincé sur ton siège…).
- Un alcool ?
AT : Le Bloody Mary (celui très moyen que l’on te sert dans l’avion).
- Une chanson ?
AT : Une chanson du chanteur Séverin (mon frère).
- Une œuvre d’art ?
AT : Un mobile de Théo Jansen.
UN PHOTOGRAPHE + UN LABO
Ambroise Tezenas & Processus
- Pourquoi avez-vous choisi Processus ?
AT : Je suis venu chez Processus parce que les photographes que je respectais, (sans forcément les connaître) venaient chez vous - ce qui vous fait déjà une bonne publicité…
Dans un monde où il y a de plus en plus d’images, où tout va dans tous les sens, le développeur, le tireur, le travail du labo, comme le travail d’une galerie, c’est primordial. Au labo, tu parles image, tu parles photo, tu as les mêmes références. Et ce rapport amical, ce lien, c’est aussi ce qui donne à ton travail une certaine cohérence, comme un chemin que tu suis.
L’ARRÊT SUR IMAGE d’Ambroise Tezenas
AT : Il s’agit d’une photo que je ne voulais pas faire mais que j’ai faite malgré tout. Depuis, cela m’a servi de leçon.
J’étais dans une ruelle à Pékin, c’était le soir, tard. Je me rappelle très bien être passé dans cette rue, m’être dit qu’il y avait peut-être une photo à faire. Seulement, quand on fait des photos à la chambre, à moins qu’elle soit déjà sortie et bien que je sois très rapide - il faut quand même un certain temps pour s’installer, sortir le trépied, etc. Je me souviens d’avoir hésité, ressentir la fatigue et penser rentrer à l’hôtel, être revenu en arrière finalement et me dire qu’il fallait la faire quand même… Il se trouve que cette image a servi de couverture au livre. Maintenant, à chaque fois que j’hésite longtemps à faire une photo, je décide de la faire.
Je me souviens par ailleurs, quand j’assistais Gueorgui Pinkhassov, de l’agence Magnum, sur un reportage à l’opéra Bastille et à l’opéra Garnier où je le suivais en tant qu’assistant, moi portant son sac, son matériel et lui shootant, furtivement : le soir, éreinté d’avoir crapahuté toute la journée (à l’époque on travaillait en ekta) alors que tu n’as qu’une seule envie, rentrer à la maison, Pinkhassov remettait un dernier film. Mais c’était vraiment le film de la fatigue, de l’épuisement. Et quand je le voyais remettre son film, en moi-même, je me disais « Non ! », et il faisait les toutes dernières photos de la journée, pas forcément les meilleures, simplement pour aller au bout de soi-même. Et sur le trajet du retour, souvent, Pinkhassov s’endormait dans le taxi. La photo doit se faire, et parfois dans l’adversité, vis-à-vis de soi-même, de la pluie, du froid, de la fatigue, de l’envie - on n’est pas dans le plaisir, mais on y va quand même. Le plaisir, ce sera après.
Interview : Sandrine Fafet
(Mars 2018)